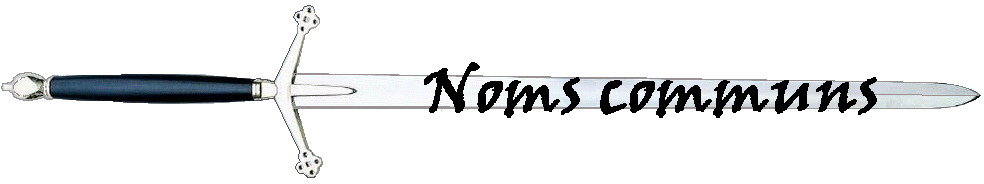
I. ACCUEIL
II. ARMEMENT
III. CIVILISATION IV.
GLOSSAIRES V. HABITATIONS
VI. HERALDIQUE VII.
HISTOIRE
VIII. HOMMES IX. INSOLITE
X. SOURCES &
LIENS XI. QUESTIONS & IDEES
XII. COUP DE MAIN XIII. LIVRE D'OR
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
 Thèmes
particulièrement approfondis :
Thèmes
particulièrement approfondis :- 1.) Architecture : bâtiments, particularités... Repris en détail au chapitre V Habitations
- 2.) Armement : armes, armures, équipement, accessoires... Repris en détail au chapitre II Armement
- 3.) Arts : type et construction des oeuvres, artistes, instruments...
- 4.) Chasse, fauconnerie et vénerie : techniques, chiens et rapaces, comportement et anatomie du gibier...
- 5.) Héraldique : formes, couleurs, partitions, meubles, ornements... Repris en images au chapitre VI Héraldique
- 6.) Monnaies : pièces, métaux, valeurs... Repris en détail et en images au chapitre III Civilisation - Monnaies
- 7.) Politique : partis et factions, système féodal, impôts, soulèvements populaires, grandes alliances...
- 8.) Religion : rites, pratiques, objets liturgiques, déviances, hérésies...
 Abîme
ou Abyme
Abîme
ou Abyme
- nom masculin. En héraldique et dans le vocabulaire des Beaux Arts, partie centrale. Dans le vocabulaire des blasons, on utilise plus fréquemment l'orthographe abyme. La partie en abyme n'est pas chargée d'une autre pièce et ne touche aucune autre pièce du blason (voir VI Héraldique)
 Abjurer
Abjurer
- verbe transitif, du latin abjurare. Renoncer publiquement et solennellement à une religion, une croyance, une hérésie.
 Ablution
Ablution
- nom féminin, du latin ecclésiastique ablutio (purifier,
nettoyer).
- 1.) Dans la messe, le vin que le prêtre prend après la communion.
- 2.) Le vin et l'eau qu'on verse sur les doigts du prêtre et dans le calice après qu'il a communié.
- 3.) Dans les ordres religieux qui portent des habits blancs, l'action par laquelle on les blanchit et on les nettoie. Dans les cloîtres, des écriteaux sont apposés pour marquer les jours d'ablution.
- 4.) Pour les apothicaires, médecins et chirurgiens du Moyen Age, l'ablution est une "préparation du médicament dans quelque liqueur, pour le purger de ses immondices ou de quelque mauvaise qualité" (extrait du Dictionnaire de Trévoux, 1743).
 Aboi,
Abois
Aboi,
Abois
- 1.) nom masculin singulier. Cri ou aboiement (rôle actif) du chien, de la meute au moment où elle entoure la bête et l'accule.
- 2.) nom masculin pluriel. Un animal aux abois (rôle passif) est cerné par la meute et ne peut plus fuir.
- 3.) Par extension, l'expression Être aux abois signifie l'absence de solution de repli.
 Aboyeur
Aboyeur
- nom masculin, de abayeur. Terme de vénerie. Chien de chasse qui aboie à la vue du sanglier et reste à distance sans l'attaquer.
 Absolution
Absolution
- nom féminin, du latin absolutio.
- 1.) singulier. Effacement d'une faute par le pardon religieux ou juridique. L'accusé est reconnu coupable mais n'est pas puni. Ne pas confondre avec l'acquittement, où l'accusé est déclaré innocent.
- 2.) singulier. Courte prière que récite l'officiant à chaque
nocturne des matines avant les bénédictions et les leçons.
- 3.) pluriel. Les encensements et aspersions d'eau bénite sur le corps des princes et des prélats qu'on enterre en grande cérémonie.
 Accouer
Accouer
- verbe, du provençal acoatar (à queue).
- 1.) Attacher des chevaux ensemble, de manière que le licou de celui qui suit soit lié à la queue de celui qui précède. Les animaux marchent alors en file.
- 2.) En vénerie, se dit lorsque le veneur qui suit le cerf le rejoint pour lui porter un coup de dague au défaut de l'épaule ou lui couper le jarret. Le veneur vient d'accouer le cerf. Le cerf est accoué.
 Accouple
Accouple
- nom féminin, de accoupler (lien). Terme de vénerie. Lien qui sert à attacher ensemble des chiens de chasse.
 Acharner
Acharner
- verbe, du latin ad (à) et carnis (chair). Terme de vénerie. Donner le goût de la chair, du gibier à un faucon ou un chien de chasse.
 Acolyte,
Acolytat
Acolyte,
Acolytat
- nom masculin, du latin médiéval acolytatus. Clerc promu au plus élevé des quatre Ordres Mineurs, dont l'office est de porter les cierges, de préparer le feu, l'encensoir, le vin et l'eau, de servir le Prêtre à l'autel etc...
 Actif,
Active
Actif,
Active
- adjectif, du latin scolastique activus (agir). Engagement religieux qui s'exprime par des actes extérieurs de piété, par opposition à la vie contemplative, qui consiste dans les sentiments et dans les affections de l'âme.
 Admonition
Admonition
- nom féminin, du latin ecclésiastique admonitio (avertissement, conseil). Admonestation religieuse ou judiciaire.
 Adoubement
Adoubement- 1.) nom masculin, du germanique dubban (frapper). Cérémonie à la fois religieuse et militaire, qui consiste à armer chevalier un bachelier et lui remettre ses armes et son armure. (voir III Civilisation - Adoubement)
- 2.) nom masculin, altération du verbe adoubler (garnir d'une doublure). Tunique de tissu ou de cuir renforcée par des clous, de petites plaques ou des anneaux de métal. On y adjoint des chausses et des manches de la même composition. On lui substitue le terme d'armure au sens général.
 Affaiter
Affaiter
- verbe, de l'ancien français afaiter ou afaitier (préparer). En vénerie, apprivoiser et dresser un faucon pour la chasse.
 Affrontés,
Affrontées
Affrontés,
Affrontées
- adjectif pluriel. En héraldique, se dit de deux animaux qui se regardent, qui sont figurés face à face. L'expression reste valable si les animaux ne sont pas dans le même quartier, et si d'autres pièces les séparent (voir VI Héraldique)
 Affût
Affût
- nom masculin, de à et fustis (bâton, tronc), XIe siècle.
- 1.) Endroit camouflé où le chasseur s'embusque pour surprendre le gibier de passage.
- 2.) Par extension, l'expression Etre à l'affût signifie épier et attendre pour saisir l'occasion.
- 3.) Assemblage de pièces de bois ou de métal, avec ou sans roues, qui sert de support à une bouche à feu, à un canon.
 Agneau
Agneau
- nom masculin, du bas latin agnellus.
- 1.) En symbolique religieuse, l'agneau représente Jésus-Christ, victime sans tache qui efface les péchés du monde.
- 2.) En héraldique, symbole de la douceur et de la franchise. L'agneau pascal est représenté tenant une banderole (voir VI Héraldique)
 Agnel
ou Aignel
Agnel
ou Aignel
- nom masculin, de agneau. Monnaie d'or française qui figure un agneau ou un mouton avec la devise Ecce Agnus Dei d'un côté, et saint Jean-Baptiste sur son revers. Elle porte des noms variables, tantôt denier d'or à l'aignel, florin d'or à l'aignel, moutons d'or à la grande laine ou encore moutons d'or à la petite laine. Créée vraisemblablement par Saint Louis, elle perdure jusqu'en 1336. A partir de Philippe de Valois, les rois y présentent leurs écus, d'où la transformation du nom de la monnaie en écu.
 Agrafe
ou Agraffe
Agrafe
ou Agraffe
- nom féminin, du germain krappa (crochet).
- 1.) Attache en forme de crochet, cousu ou rivé sur un pan du vêtement. Equivalent du fermail.
- 2.) En architecture, crampon de métal qui empêche les pierres de se désunir.
 Agrier
ou Agrière
Agrier
ou Agrière
- nom commun, du latin ager (champ). voir Champart.
 Agynien
ou Agynnien
Agynien
ou Agynnien
- adjectif et nom, de a (privatif) et gynê (femme). Hérétique de la fin du VIIe siècle (vers 694), qui prétend que Dieu n'a pas permis l'usage des viandes et du mariage. Ils proscrivent évidemment le mariage.
 Aide,
Aides
Aide,
Aides
- 1.) nom masculin, du latin adjuvare (ajouter). Adjoint, suppléant. On connaît les Aides de Paneterie et d'Échansonnerie, qui sont mentionnés dans une Ordonnance du 17 novembre 1317 en qualité d'Officiers de l'Hôtel de Philippe Le Bel. Il y avait trois Aides des Queux de la cuisine du Roi en 1359, ainsi que quatre Valets et de deux Aides de Fourrière. La Chasse de Gaston Phébus fait état d'un Aide de Vénerie.
- 2.) nom indifféremment masculin ou féminin. Impôt, subsides, levées de deniers qui se faisaient sur le peuple pour aider à soutenir les dépenses de l'État. Au XIIe siècle, époque où la féodalité est constituée, l'homme libre ne doit payer d'impôts extraordinaires que dans quatre cas : a) quand le seigneur arme son fils chevalier (aide de chevalerie), b) quand il marie sa fille aînée (aide de mariage), c) quand il est retenu prisonnier (aide de rançon), d) quand il part pour la croisade (aide-chevel). On trouve un cinquième cas dans certaines provinces : quand il rachète une partie aliénée de son fief, ou quand il fait une acquisition, mais il est souvent limité à une seule fois par vie d'homme. Ce sont les aides légales ou loyaux (auxilium legale, prescrits par la loi). Les ecclésiastiques ont leur propre système d'impôts, que l'on nomme coutumes épiscopales, coutumes synodales ou denier de Pâques. En Franche-Comté, des abbés lèvent des aides loyaux : a) quand ils vont en cour de Rome, b) quand ils sont intronisés, c) quand ils vont à la croisade, d) quand ils font l'acquisition d'une terre. L'impôt est généralement fixe. Ce mot garde sa signification jusqu'à Charles VII, mais son sens se restreint : aide ne signifie plus impôt extraordinaire, mais impôt indirect et il ne s'applique plus qu'à certains impôts indirects. Louis XI restreint le droit d'aide à certaines marchandises : vin, bétail, poisson de mer, bois à brûler, draperies. Cette aide consiste en un sou par livre, d'où son nom de gros ou de vingtième. Le vin en détail est de plus frappé d'un droit spécial (le quart du prix, réduit au XVIIe siècle en un huitième du prix). Le droit de gros sur la draperie est supprimé en 1644, les autres perdurent jusqu'à la Révolution. Les aides royaux ne sont pourtant pas uniformes sur tout le territoire. Ainsi le quart sur le vin ne se lève pas dans toute la France. Certaines provinces, comme la Bretagne, en sont exemptes. D'autres provinces, le Poitou, le Maine, etc... substituent au droit de gros une somme payée d'avance ou abonnement dit équivalent. Enfin à Paris, on le remplace par des droits d'entrée, dont la moitié est généralement réservée au gouvernement. Il existe même une juridiction spécifique, les douze Cours des Aides, établies respectivement à Aix, Bordeaux, Chalons, Dijon, Grenoble, Metz, Montauban, Montpellier, Nantes, Paris, Pau et Rouen.
- 3.) nom féminin pluriel. Moyens employés par le cavalier pour agir sur son cheval. On fait maintenant la distinction entre les aides naturelles (assiette, jambes, rênes) et les aides artificielles (éperons, mors...).
 Aignel
Aignel
- voir Agnel ou Aignel.
 Aiguillette
Aiguillette
- nom féminin, diminutif d'aiguille. Lacet terminé à chaque extrémité par un ferret, qui sert à fermer le pourpoint ou simplement de décoration. Il peut servir également à attacher les chausses au pourpoint. Nouer l'aiguillette signifie lancer un prétendu maléfice, que le peuple croit capable d'empêcher la consommation d'un mariage.
 Ailette
Ailette
- nom féminin, diminutif d'aile. Appendice placé sur les épaulières dans les armures du commencement du XIVe siècle. Elle est régulièrement utilisée par les Croisés et souvent décorée d'un blason. L'ailette protège principalement contre les coups de masses ou d'épée portés sur la tête et qui retombent sur l'épaule quand ils sont déviés par le heaume. C'est la première pièce d'armure de fer à apparaître sur la cotte de maille. Elle disparaît progressivement vers la fin du XIVe siècle.
 Aînesse,
droit d'aînesse
Aînesse,
droit d'aînesse- nom féminin, de aîné. Appelé aussi droit de primogéniture, il privilégie l'aîné des enfants mâles dans une succession et ne s'applique qu'entre frères et soeurs. Pour l'accès au trône de France, le droit d'aînesse est introduit par Hugues Capet. Avant lui, Clovis et Louis le Débonnaire avaient partagé le pays entre tous leurs fils.
 Alain
Alain- voir Dogue alain.
 Albigeois
Albigeois
- adjectif et nom, du latin Albiga (Albi). Hérétiques du XIIe siècle dans les environs de Toulouse, qui tiennent leur nom de la ville d'Albi. On les nomme également Cathares, Passagers, Patarins, Publicains ou Tisserans, eux-mêmes préfèrent s'appeler les Parfaits. Leur foi relève du manichéisme et est introduite dans le Languedoc à partir de 1126 par Pierre de Bruys Provençal, qui est brûlé à St Gilles une vingtaine d'années plus tard. Ils reconnaissent une hiérarchie ecclésiastique composée de prêtres, de diacres et d'évêques. Leur pape tient son siège en Bulgarie, d'où l'autre appellation de Boulgres. Au début du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste et le pontificat d'Innocent III, l'hérésie prend une telle expansion que les Catholiques ne trouvent rien de plus efficace à leur opposer qu'une croisade et les religieux de Cîteaux forment le projet de cette sainte ligue. Les Albigeois sont condamnés en 1180 au concile de Latran. Philippe Auguste en sollicite l'exécution auprès du Saint Siège et le Pape, en qualité de père commun des fidèles, lève le premier l'étendard de la Croix. Le roi Louis VIII poursuit cette guerre qui ne finit qu'en 1228, lorsque le comte de Toulouse Raymond X le Jeune se réconcilie avec l'Eglise catholique. L'Inquisition s'installe alors à Toulouse pour détruire les derniers symboles de l'hérésie. Les calvinistes considèrent les Albigeois comme leurs prédécesseurs et leurs pères.
 Alchimie
ou Alchymie ou Alquemie
Alchimie
ou Alchymie ou Alquemie- nom féminin, de l'arabe al-kîmiyâ. Science occulte du Moyen Age qui se fonde sur un symbolisme des minéraux et des planètes. Les alchimistes cherchent à établir des liens entre le monde matériel et le monde spirituel. Leur principal sujet est la recherche de la pierre philosophale (voir III Civilisation - Sciences)
 Alérion
Alérion
- nom masculin, de l'allemand Adler (aigle). En héraldique, petit aigle représenté avec les ailes déployées, sans bec ni pattes (voir VI Héraldique)
 Alésé,
Alésée
Alésé,
Alésée
- adjectif, de a privatif et lès ou lez (côté). En héraldique, se dit d'une pièce honorable (bande, barre, fasce, pal...) diminuée de longueur et dont une extrémité ne touche plus le bord de l'écu (voir VI Héraldique)
 Alleu,
Franc-Alleu, Alleutier, Allodial
Alleu,
Franc-Alleu, Alleutier, Allodial- nom masculin, originaire du vieil allemand all od (propriété entière). Propriété héréditaire et exempte de toute redevance, par opposition au fief. Dans la loi salique, l'alleu désigne tout ce que l'on reçoit par héritage et sans conditions, au contraire des acquêts et du bénéfice, qui imposent la charge de redevances. Le nombre des alleux diminua à mesure que le système féodal prenait de l'extension. Tenir en franc-alleu, c'est tenir terre de Dieu seulement. Le franc-alleu noble ne doit pas être confondu avec le franc-alleu roturier. Bien quoiqu'ils soient égaux en franchise, ils différent en ce que le franc-alleu noble a droit de justice et que le franc-alleu roturier est terre sans justice. L'alleutier est un homme libre, propriétaire d'un alleu. L'adjectif est allodial.
 Alliance
Alliance
- nom féminin, du latin alligare (allier). Dans le vocabulaire religieux, l'Ancienne Alliance représente le pacte entre les Hébreux et Yahweh, fondement de la religion juive. La Nouvelle Alliance représente le pacte entre Dieu et tous ceux qui reconnaissent le sacrifice du Christ, fondement du christianisme. L'Arche d'Alliance pour les Juifs est le coffre où furent enfermées les deux Tables de la Loi où Dieu avait gravé ses Commandements et qui furent données à Moïse sur la Montagne. L'Arche d'Alliance fut prise par les Philistins, puis renvoyée avec plusieurs présents.
 Allumé,
Allumée
Allumé,
Allumée
- adjectif, du latin alluminare (allumer). En héraldique, se dit de l'oeil d'un animal qui est d'un autre émail que le reste du corps, ou d'une flamme d'un émail différent (voir VI Héraldique)
 Allumée
Allumée
- nom féminin, altération de aumusse. Coiffure de tête, chaperon. Charles VI l'emploie dans ses correspondances lorsqu'il accuse le dauphin Charles (futur Charles VII) d'avoir organisé le meurtre du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, le 10 septembre 1419 à Montereau. Charles VI raconte : "Ledict Charles (le Dauphin) mit tantost la main à son allumée, fesant semblant de saluer nostre dict Cousin (Jean sans Peur), et à l'ombre de son bras guigna des yeux, et feit signe à ses gens pour venir férir sur nostre dict Cousin...". Selon les sources, on trouve allumée ou aumusse pour ce même passage.
 Alouette
Alouette
- nom féminin, du latin d'origine gauloise alauda. Petit gibier, oiseau à plumage gris ou brunâtre de la famille des passereaux.
 Amalgamation
ou Amalgame
Amalgamation
ou Amalgame
- nom masculin, du latin alchimique amalgama. En alchimie, le mélange de mercure avec un autre métal (sauf fer et cuivre), qu'il liquéfie et en permet la séparation.
 Âme
Âme
- nom féminin, du latin anima (souffle).
- 1.) Dans le domaine religieux, c'est le principe spirituel et immatériel de l'homme et de sa vie, conçu comme séparable du corps, immortel et jugé par Dieu. Certaines hérésies ont reconnu deux âmes en chacun de nous, une bonne, principe des bonnes actions, et l'autre mauvaise, principe de nos mauvaises actions.
- 2.) En héraldique, légende qui explique la figure d'une devise.
- 3.) Partie centrale d'un canon, où l'on place la poudre et le boulet, par où l'on tire.
 Ameuter
Ameuter
- verbe transitif, de meute. Regrouper les chiens en meute pour la chasse à courre.
 Ampoule
Ampoule
- nom féminin, du latin ampulla.
- 1.) Petite fiole ventrue à col long utilisée par les scientifiques (alchimistes).
- 2.) La Sainte Ampoule est la fiole qui contient l'huile consacrée à l'onction des rois de France. Cette fiole aurait été apportée à saint Rémi par une colombe pour le baptême de Clovis et est gardée à l'abbaye de saint Rémi de Reims. Clovis institue un Ordre des Chevaliers de la Sainte Ampoule dès l'an 485. Les chevaliers ne doivent être que quatre, ce sont les barons de Terriers, de Belestre, de Senestre et de Louversy. Leur fonction est d'assister l'évêque lorsqu'il porte la Sainte Ampoule. Ils n'ont pas de bannière particulière puisque la dignité de leur fonction suffit pour les distinguer parmi tous les autres chevaliers. Dans une description des Ordres militaires imprimée à Paris en 1671, on leur attribue également le nom de Chevaliers de saint Remi. La limitation à quatre chevaliers permet difficilement de l'inclure parmi les ordres militaires.
 Amulette
Amulette
- nom féminin, anciennement masculin, du latin amuletum (amulette). Petit objet que l'on porte sur soi, éventuellement en pendentif, auquel la crédulité et la superstition attribuent un pouvoir de protection. Les médecins du Moyen Age y recourent régulièrement.
 Anathème
Anathème
- nom et adjectif, du latin ecclésiastique anathema et grec théologique (séparer).
- 1.) nom masculin. Excommunication majeure ou malédiction prononcée contre les hérétiques ou les ennemis de la foi catholique. L'anathème judiciaire est émis par un évêque, un concile ou le pape. L'anathème abjuratoire permet à un hérétique converti de rejeter "l'erreur" de son hérésie.
- 2.) nom masculin ou féminin. Par extension, toute personne frappée de cette sanction.
- 3.) adjectif. Excommunié, retranché de la vie des fidèles.
 Ancré,
Ancrée
Ancré,
Ancrée
- adjectif, du latin ancora (ancre). En héraldique, se dit des croix et des sautoirs dont les bouts sont divisés et tournés comme les pattes d'une ancre. Les différentes parties d'une ancre ont des noms particuliers. Le bois traversant qui est au dessus s'appelle trabe. Le fer droit qui entre dans la trabe s'appelle stangue et le cordage est appelé gumene. Les Amiraux mettent une ancre derrière leur écu pour marque de leur charge. L'ancre est le symbole de l'espérance (voir VI Héraldique)
 Andouiller
Andouiller
- nom masculin, de l'anglais antler (andouiller). Ramification des bois du cervidés (cerf, daim, chevreuil...). Leur taille permet de connaître l'âge de l'animal. Gaston Phébus les appelle antoilliers.
 Ange
ou Angelot
Ange
ou Angelot
- nom masculin, de ange. Monnaie d'or française en usage à partir de 1340 sous Philippe VI de Valois, d'une valeur nominale d'un écu d'or fin. Elle porte l'image de saint Michel qui tient une épée dans la main droite et un écu chargé de trois fleurs de lys dans la main gauche, avec à ses pieds un serpent. Dans l'Edit qui en ordonne la fabrication, les Anges sont nommés Angelots. Ils pèsent 5 deniers 16 grains et on les appelle premiers Anges. A partir de 1342, on en voit apparaître plusieurs déclinaisons. Toujours d'or fin, on en frappe ensuite qui ne pèsent que 5 deniers et que l'on appelle seconds Anges. Les derniers ne pèsent plus que 4 deniers 13 grains, ce sont les troisièmes Anges. Il existe aussi des demi-Anges. Le roi Henri IV d'Angleterre a aussi frappé des Anges portant les armes de France et d'Angleterre, d'une valeur de quinze sols, qui remontent à l'époque où il était maître de Paris. Cette monnaie a perduré en France au moins jusqu'au règne de Louis XI.
 Angélus
Angélus
- nom masculin, du latin angelus (ange). Sonnerie de cloches annonçant une prière de dévotion mariale. D'abord instituée le soir, on lui ajoute progressivement le matin, puis le midi. Promulguée en France par l'archevêque de Tours Elie de Bourdeille, elle est ratifiée par Louis XI. L'Angélus est également une toile célèbre de Jean-François Millet (° 1814, U 1875)
 Angusticlave
Angusticlave
- nom masculin, du latin angustus (étroit) et clavus (clou). Tunique des chevaliers, héritée des Romains. Son nom lui vient de l'opposition entre la robe des chevaliers et celle des sénateurs. Les tenues des chevaliers portaient des bandes de pourpre étroites alors que le laticlave des sénateurs était décoré de bandes pourpre très larges. Les ornements de ces vêtements ne nous sont exactement connus, mais leur forme évoquait un clou. Le nom clavus a ensuite directement désigné l'habit complet.
 Antipape
Antipape- nom masculin, du latin médiéval antipapa. Usurpateur de la papauté au détriment d'un pape élu légitimement selon le droit canon. On en compte 41 jusqu'à la fin du Moyen Age, dont Boniface VII, qui fut antipape à deux reprises. Le premier d'entre eux, Saint Hippolyte, n'est pas admis comme pape par l'Eglise tout en étant reconnu comme saint.
 Antiphonaire
Antiphonaire- nom masculin, du grec antiphôna (antienne). Livre liturgique contenant les antiennes et les repons des psaumes, c'est à dire les versets qui précèdent et suivent les psaumes aux différentes heures de l'office, en utilisant la notation grégorienne.
 Antiquité
Antiquité- du latin antiquus. Période de l'Histoire regroupant généralement les civilisations grecque et romaine jusqu'aux invasions barbares autour de l'an 400. Le Moyen Age débute officiellement en 476, après la chute de l'empire romain d'Occident.
 Apanage
Apanage- nom masculin. Portion du domaine royal que le roi attribue à ses fils puînés pour leur subsistance, mais qui revient à la couronne en cas d'extinction de la descendance mâle. Il présente l'avantage de ne plus morceler le domaine royal. Le roi Jean commença à ne les donner qu'aux héritiers mâles, Philippe III (règne 1270-U1285) fixa les apanages à dix mille livres, Philippe IV (règne 1285-U1314) à vingt mille livres. Au sens figuré : privilège.
 Apocrisiaire
Apocrisiaire- nom masculin, du grec apokrisiarios (envoyé). D'abord messager d'un prince vers un autre, cette charge évolue en messager et représentant du pape, puis en représentant officiel du pape auprès d'un chef d'état non catholique, l'équivalent d'un nonce auprès d'un prince chrétien. Les apocrisiaires ont un rang inférieur aux évêques, mais on en rencontre parfois avec des prérogatives de légat, devançant même les patriarches. Saint Grégoire le Grand est ainsi l'apocrisiaire du pape Pélage II auprès de l'empereur à Constantinople, mais d'autres papes ont également rempli cette fonction. L'hérésie des monothélites, soutenue par l'empereur, freine considérablement l'envoi de tels conseillers et la pratique cesse avec l'hérésie des iconoclastes, également soutenue par l'empereur. Par la suite, ce sont des cardinaux dotés de pouvoirs de légats qui assureront cette charge.
 Apostasie
Apostasie
- nom féminin, de apostasia (éloignement). Abandon public d'une religion (essentiellement chrétienne) au profit d'une autre. Parfois employé à tort à la place de se défroquer.
 Apostolique
Apostolique
- du grec apostolikos.
- 1.) adjectif. En terme de religion, qui émane des apôtres (doctrine, tradition apostolique), voire du Saint Siège (nonce apostolique, bref apostolique). Saint Grégoire le Grand (pontificat 590-U604) réserva le titre au seul pape. Un évêque espagnol qui se l'était attribué fut excommunié. Tous les Saints Sièges étaient qualifiés d'apostoliques mais le concile de Reims en 1049 constata que trois d'entre eux étaient aux mains des infidèles (Alexandrie, Antioche et Jérusalem). Seule Rome put continuer à porter le nom d'apostolique.
- 2.) nom commun. Hérétiques du XIIIe siècle qui prônaient le renoncement au mariage et aux biens du monde, comme les apôtres.
 Apothicaire
Apothicaire
- nom masculin, du bas-latin apothecarius (mise en réserve). Qui se consacre à la partie de la Médecine qui consiste à préparer les remèdes. A Paris, les apothicaires prennent aussi la qualité de Marchands Espiciers & Droguistes. Appellation ancienne du pharmacien (voir III Civilisation - Sciences)
 Appareil
Appareil
- nom masculin, du bas latin appariculare (préparer). En architecture, façon de disposer les pierres d'une construction. Les maçons l'utilisent pour qualifier la hauteur d'une pierre. Toutes les pierres d'un même lit doivent être du même appareil, de la même taille.
 Appatiz
Appatiz
- nom masculin, vraisemblablement de appactis (pacte). Rançon demandée par les Ecorcheurs pour épargner les marchands et leurs biens durant la Guerre de Cent Ans. Le verbe appactir (on trouve aussi appactizer) signifie "obliger à payer une contribution fixée par un pacte". Dans le Journal de Paris, écrit sous Charles VI, on lit : "Tous les villaiges d'entour Paris estoient apatiz aux Armagnacs". Dans les Mémoires de Comines, on trouve : "Ne seront faites aucunes prises de personnes, courses, voleries, pilleries, logis, appatis, rançonnement de bestes ou d'autres biens quelconques, sur les terres, villes.... et autres lieux estans du parti et obeissance du Roy". Même Froissart décrit la situation difficile des paysans : "Ils ne pouvoyent labourer leurs terres... pour la doutance des pillars, s'ils n'estoyent bien acconvenancés et appactis".
 Arbalète
ou Arbaleste ou Arbalestre
Arbalète
ou Arbaleste ou Arbalestre- nom féminin, littéralement "baliste à arc", du bas latin arcus (arc) et balista (baliste). Arme de trait formée d'un arc ordinaire placé à l'horizontale et fixé sur un fût de bois destiné à diriger le projectile. (voir II Armement - Armes de jet) D'autres applications de tailles plus conséquentes ont été développées pour assiéger les places fortes (voir II Armement - Siège).
 Arbrier
Arbrier- nom masculin, de arbre (sens de fût). Fût de l'arbalète sur lequel est fixé l'arc et muni d'une rainure destinée à recevoir et diriger le projectile (balle, carreau ou vireton). Il supporte enfin le mécanisme de détente (la noix).
 Arc
Arc- nom masculin, du latin arcus. Arme formée d'une verge de bois, de corne ou de métal, que l'on courbe au moyen d'une corde tendue avec effort, et servant à lancer des projectiles (flèches). (voir II Armement - Armes de jet)
 Arcane
Arcane
- nom féminin, du latin arcanum (secret). En alchimie, opération mystérieuse de transformation, secret de fabrication.
 Archais
Archais- nom masculin. Etui de cuir qui protège l'arc et les cordes de rechange. Ne pas confondre avec le carquois.
 Archère
ou Archière
Archère
ou Archière- nom féminin, de arc. Ouverture longue et étroite dans les murailles, pour tirer de l'arc ou de l'arbalète depuis un couvert (voir V Habitations - Fortifications)
 Archétype
Archétype- nom masculin, du grec arkhetupon. Terme de copiste. Manuscrit qui sert de modèle à tous les autres.
 Archevêque
Archevêque
- nom masculin, du grec arkhô (commander) et évêque. Prélat placé à la tête d'une circonscription ecclésiastique comprenant plusieurs diocèses. Archevêque du Sacré Palais est l'un des titres de l'archichapelain des rois de France et des empereurs d'Allemagne.
 Archidiacre
Archidiacre
- nom masculin, du latin ecclésiastique archidiaconus. Dignitaire ecclésiastique ayant le pouvoir de visiter les curés d'un diocèse. Crotté en archidiacre signifie très crotté, parce que les archidiacres faisaient leurs visites à pied. Bander en Archidiacre n'a pas la connotation libertine attendue. L'archidiacre suit l'archevêque lorsqu'il confère le Sacrement de la Confirmation, et c'est lui qui applique le bandeau sur le front du Confirmé.
 Arçon
Arçon- nom masculin, du latin populaire arcio, arcionem (arc). Armature de la selle, formée de deux arcades (le pommeau vers l'avant et le troussequin vers l'arrière), reliées latéralement par deux bandes de bois ou de métal. Vider les arçons signifie tomber de sa monture.
 Ardents,
mal des Ardents
Ardents,
mal des Ardents
- voir Feu de Saint-Antoine.
 Argent
Argent
- nom masculin. En héraldique, métal correspondant au blanc. En gravure, il est représenté blanc et uni. Il est le symbole de la justice, de la pureté, de l'innocence, de la chasteté, de l'humilité, de la beauté, de la victoire, de la félicité (voir VI Héraldique)
 Arianisme
Arianisme
- nom masculin. Hérésie chrétienne d'Arius (256-U336) qui nie l'unité et l'identité de substance du Fils avec le Père. Elle ne reconnaît que partiellement la nature divine de Jésus et contredit le dogme de la Trinité. Cette hérésie se propage en Afrique avec les Vandales et en Europe avec les Goths, puis s'éteint d'elle-même vers le VIIe siècle.
 Armagnacs,
parti des Armagnacs
Armagnacs,
parti des Armagnacs- Durant la guerre de Cent Ans, sous le règne de Charles VI et de Charles VII, faction qui s'oppose dans une guerre civile à la faction des Bourguignons, laquelle soutient les Anglais. Elle doit son nom à l'un de ses chefs, Bernard VII d'Armagnac. Le traité d'Arras met fin à la guerre civile en 1435. Ils prennent pour emblème l'écharpe rouge.
 Arme,
Armes
Arme,
Armes
- nom féminin, du latin arma.
- 1.) singulier. Défense de sanglier.
- 2.) singulier. Tout instrument qui sert à se défendre ou à attaquer, à tuer, blesser ou à mettre un ennemi dans l'impossibilité de se défendre. On les classe suivant leur nature. Ainsi, les armes d'estoc et de taille regroupent les différentes lames comme couteau, coutelas, dague, épée, glaive, poignard, sabre et stylet ; les armes de choc concernent bâton, canne, casse-tête, coup-de-poing, maillet, marteau, masse, massue et matraque ; les armes d'hast, emmanchées au bout d'une hampe, telles qu'épieu, faux, fléau, fourche, framée, francisque, hache, hallebarde, lance, pertuisane et pique ; enfin les armes de jet et leurs projectiles, arbalète, arc, fronde, javeline ou javelot, relayées vers la fin du Moyen Age par les armes à feu que sont les arquebuses et autres canons (voir II Armement)
- 3.) pluriel. Les armes pleines représentent l'équipement standard de l'homme de guerre au Moyen Age tel que défini dans le code de la chevalerie. Pour un écuyer, elles comprennent le roussin, le gambison, le chapel et la lance. Pour un chevalier, il lui faut le cheval, le haubert, l'écu, l'épée et le heaume.
- 4.) pluriel. En termes de blason, se dit de certaines marques propres et héréditaires à chaque maison noble, peintes ou figurées sur l'écu et sur la cotte d'armes. Synonyme d'armoiries (voir VI Héraldique)
 Armé,
Armée
Armé,
Armée
- adjectif, du latin arma. En héraldique, se dit des ongles, du bec, des cornes, des griffes et des dents des lions, des griffons, des aigles et autres prédateurs, mais aussi des flèches qui auraient leur pointe d'une autre couleur que le fût (voir VI Héraldique)
 Armet
Armet- nom masculin, de arme ou de elmet (petit heaume), avis très partagés. Casque des hommes d'armes en usage du XVe au XVIe siècle en remplacement du bassinet. Complètement clos, il protège la tête et la nuque car il se compose d'un timbre arrondi surmonté d'une crête plus ou moins saillante, de pièces mobiles pour protéger le visage, mézail, nasal, ventail, mentonnière et enfin d'un gorgerin. L'Académie Française ne retient son usage que pour les chevaliers errants, dans les vieux romans. Le plus célèbre est l'armet de Mambrin.
 Armoiries
Armoiries- nom féminin pluriel, du latin arma (armes). Ensemble des signes, devises et ornements intérieurs et extérieurs de l'écu d'un état, d'une ville, d'une famille noble. On distingue plusieurs sortes d'armoiries :
- 1.) les armoiries de domaine ou de souveraineté (pays, terres et fiefs qui appartiennent à un seigneur)
- 2.) les armoiries de prétention (domaine sur lequel un prince croit avoir des droits)
- 3.) les armoiries de concession (concédées par un souverain)
- 4.) les armoiries de patronage (indiquant une protection particulière)
- 5.) les armoiries de famille (qui sont légitimes, vraies, pleines, pures, brisées, bâtardes, parlantes...)
- 6.) les armoiries de dignité (destinées à faire connaître les charges spéciales du propriétaire)
- 7.) les armoiries de communauté (ordre, chapitre, corporation, société...).
- Les armoiries peuvent être pleines, parties, écartelées, coupées, fausses, à enquerre, parlantes... (voir VI Héraldique)
 Armure
Armure
- nom féminin, du latin armatura (armer)
- 1.)Assemblage articulé de plaques métalliques que l'homme d'armes revêt pour se protéger au combat (voir II Armement - Armures)
- 2.) Partie de peau très épaisse que les sangliers ont au-dessus et au défaut de l'épaule.
 Arts
libéraux
Arts
libéraux
- nom masculin pluriel, utilisé souvent au féminin jusqu'au XVIe siècle. Ils privilégient l'activité de l'esprit, par opposition aux arts mécaniques qui font appel au travail manuel ou celui des machines. Les sept arts libéraux des universités médiévales sont regroupés en deux cours d'études, le trivium (grammaire, logique et rhétorique) et le quadrivium (arithmétique, astronomie, géométrie et musique).
 Arquebuse
Arquebuse
- nom féminin, altération par arc de haquebuse, du néerlandais hakebusse (canon à crochet). Arme à feu portée sur l'épaule, qui consiste en un long canon de fer monté sur un fût de bois, qu'on fait partir au moyen d'une mèche ou d'un rouet. Elle remplace progressivement l'arc et l'arbalète sur le champ de bataille à partir de la fin du XVe siècle, rendant du même coup les armures obsolètes.
 Ascète,
Ascétisme
Ascète,
Ascétisme
- nom masculin, du latin exerceo (j'exerce). Personne qui s'impose des pénitences, des mortifications, des privations par conviction religieuse. L'ascétisme est une doctrine de perfectionnement moral fondée sur la lutte contre les exigences du corps. Il professe une vie austère, continente, frugale et rigoriste.
 Assommoir
Assommoir- nom masculin, de assommer.
- 1.) A l'entrée d'un site fortifié, ouverture pratiquée dans le plafond des premières pièces et donnant sur la pièce supérieure, permettant d'envoyer verticalement des projectiles sur les assaillants qui auraient forcé les lignes de défense extérieures.
- 2.) Piège de chasse disposé de manière à assommer certains animaux dont il ne faut pas abîmer la peau, tels que castors, renards, blaireaux...
 Athanor
Athanor
- nom masculin, de l'arabe al tannur (le fourneau). Grand fourneau à foyer central et plusieurs sorties, qui permet de travailler les matériaux à des températures différentes avec un même feu. Utilisé largement par les alchimistes, on le surnomme aussi fourneau philosophique ou fourneau des arcanes. Il assure une combustion lente et régulière et ne nécessite quasiment aucun entretien, d'où le sobriquet de Piger Henricus (en grec : qui ne demande aucun soin).
 Aube
Aube- nom féminin, du latin alba (blanc). Vêtement ecclésiastique de lin blanc que les officiants portent par-dessus la soutane pour célébrer la messe.
 Aumuce
ou Aumusse
Aumuce
ou Aumusse- nom féminin, du latin médiéval almutia. Fourrure de martre ou de petit-gris que les chanoines et les chantres portent sur le bras en allant à l'office, symbole du canonicat. L'aumuce était anciennement un bonnet de peau d'agneau avec le poil, et la chape se portait par-dessus. Ensuite on fit descendre ce bonnet sur les épaules, et par degrés jusque sur les reins. La commodité devint ensuite l'unique règle, et de là vient la variété qu'on voit dans cet habillement des chanoines, qui n'est plus même qu'un ornement pour ceux qui le portent sur le bras gauche, suivant l'usage le plus commun. Dans la Chronique de Saint Denis, il est dit qu'à l'entrée de l'Empereur dans Paris en 1377, les officiers de cuisine de Monseigneur le Dauphin portaient "des aumuces fourrées et à boutons de perle par dessus". Me Séguinat, le secrétaire de Jean sans Peur, dit dans sa déposition après l'assassinat de son maître : "Mon dit Seigneur s'en ala devers luy (le Dauphin), et osta son aumusse qui estoit de veloux noir, et se inclina devant lui d'un genoul jusques à terre, en le saluant moult humblement". Louis XI demanda au pape la permission de porter le surplis et l'aumusse.
 Aune
Aune- nom féminin, de l'ancien haut-allemand elina (avant-bras). Mesure de longueur valant 3 pieds, 7 pouces et 10 lignes 5/6, soit 1,182 mètre. Cette mesure varie en fait suivant les contrées et même selon la marchandise. Elle peut aller de 51,3 cm à 2,332 mètres. Elle est supprimée en 1840.
 Austrasie
Austrasie
- Division du royaume de France autour du VIe siècle, regroupant à peu près Reims et l'Auvergne.
 Autodafé
Autodafé
- nom masculin, du portugais auto da fe (acte de foi).
- 1.) Cérémonie au cours de laquelle le pouvoir séculier fait exécuter les jugements prononcés par l'Inquisition. Les hérétiques condamnés au supplice du feu sont conviés à faire acte de foi pour mériter leur rachat dans l'autre monde.
- 2.) Destruction par le feu.
 Autographe
Autographe- nom masculin, du grec autographos. Terme de copiste. Manuscrit écrit de la main même de l'auteur.
 Autour,
Autourserie
Autour,
Autourserie
- nom masculin, du bas latin auceptor (épervier). Oiseau de proie diurne proche de l'épervier et du milan, qui sert en basse volerie sur les perdrix et les faisans. La femelle s'appelle autour, le mâle s'appelle tiercelet d'autour. L'art d'élever et de dresser des autours se nomme autourserie. Certains termes diffèrent de ceux de la fauconnerie.
 Avares
ou Avars
Avares
ou Avars
- Peuple de race mongolique, parent des Huns. Ils envahissent l'Europe jusqu'en Autriche. Le roi Alboin des Lombards les laisse s'installer en Pannonie en 567, lorsqu'il quitte le pays pour l'Italie. Charlemagne les arrête entre 791 et 799 et les convertit au christianisme.
 Averroïsme
ou Averrhoïsme
Averroïsme
ou Averrhoïsme
- Théorie du philosophe et médecin arabe Averroès (° 1126, U1198). Selon lui, la matière est éternelle et il existe un intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'intellect actif. Il adopte une philosophie matérialiste et renie le surnaturel. Sa théorie est condamnée par l'Université de Paris, puis par l'Église en 1240, par le pape Léon X et le concile de Latran V en 1513, enfin par l'orthodoxie musulmane. Siger de Brabant est le principal représentant du courrant averroïste latin en France et l'Église le condamne à la réclusion perpétuelle.
 Avers
Avers
- nom masculin, du latin adversus (qui est en face). Face d'une pièce ou d'une médaille, opposée au revers. (voir III Civilisation - Monnaies)
 Avocat
du Diable
Avocat
du Diable
- locution. On appelle ainsi populairement le Promoteur de la Foi dans la Congrégation de Béatification et de Canonisation des Saints. Il examine avec soin les preuves de sainteté et les miracles que l'on produit, qu'il tâche d'infirmer. Il formule toutes les objections que l'on peut faire contre ces preuves et ces miracles, et tente d'empêcher la béatification ou la canonisation proposée.
 Azur
Azur
- nom masculin et adjectif, du persan lapis-lazuli (bleu). En héraldique, émail de couleur bleue. Elle symbolise la justice, la fidélité et la douceur. Elle est représentée en gravure par des hachures horizontales. (voir VI Héraldique)
 Bachelier
Bachelier
- nom masculin, de baccalariae (métairies). En termes de féodalité, jeune gentilhomme qui, n'ayant pas moyen de lever la bannière, est contraint de marcher sous celle d'autrui, qui aspire à être chevalier et tient rang entre le chevalier et l'écuyer. On appelle aussi bachelier d'armes celui qui a vaincu en tournoi pour sa première participation. Le Traité de la Noblesse de la Roque et les Ordonnances des Rois de France confirment la hiérarchie entre chevalier, bachelier et écuyer. La paye du banneret est double de la paye du bachelier, et celle de l'écuyer n'est que la moitié de la paye du bachelier. Il semble que cette distinction ait disparu sous Charles VII
 Badge
Badge
- nom masculin, de l'anglais. Insigne rond porté par un chevalier et sa suite.
 Baille
Baille
- nom féminin, soit de baculare (former de bâtons), soit de bajulare (protéger). Dans un château fort, l'avant-cour, la cour des ouvrages extérieurs, la basse cour, entourées d'une enceinte plus ou moins fortifiée. On y dispose d'ordinaire l'écurie et les communs. La baille intérieure est généralement de taille beaucoup plus réduite que la baille extérieure. La baille représente également la palissade formant l'enceinte des cours. Composée de pieux plantés dans la terre, quelquefois à un demi pied de distance les uns des autres, on s'en sert pour défendre aux ennemis les approches des faubourgs et portes des villes, d'un château, d'une tour.
 Bailleu
ou Bailleul
Bailleu
ou Bailleul
- nom masculin, du latin bajulus (celui qui soigne). Rebouteux ou rebouteur, guérisseur qui soigne les os fracturés, les côtes enfoncées, les articulations démises... On en trouve déjà trace au XIIIe siècle dans le Lai de l'Ombre. On les appelle encore Renoueurs en France, et Algebrista en Espagne
 Bailli
Bailli
- nom masculin, de l'ancien français bailler (gouverner).
- 1.) Créé par Philippe-Auguste, le bailli est un officier qui remplit des fonctions judiciaires, militaires et financières au nom du roi et a le droit de commander la noblesse quand elle est convoquée pour l'arrière-ban.
- 2.) Dans l'Ordre de Malte, chevalier revêtu d'une dignité qui le met au-dessus des Commandeurs et qui lui donne le privilège de porter la Grand-Croix..
 Baladin
ou Balladin
Baladin
ou Balladin
- nom masculin, de l'ancien français ballade (danse). Danseur de théâtre professionnel.
 Balai
Balai
- nom masculin, du breton balazn (genêt).
- 1.) En fauconnerie, queue des oiseaux de poing.
- 2.) En vénerie, extrémité de la queue des chiens.
 Baliste
Baliste
- nom féminin, du grec ballein (lancer). Machine de guerre en usage lors des sièges depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Age, qui lance des flèches de grande taille, des pierres et des objets enflammés. (voir II Armement - Siège)
 Ballade
Ballade
- nom féminin, de l'ancien provençal ballar (danser).
- 1.) Chanson qui accompagne certaines danses au Moyen Age.
- 2.) Poème français de forme régulière, composé de quatre strophes de huit à dix vers chacune. Les trois premières sont terminées par un refrain. La dernière strophe, plus courte, est appelée l'envoi. François Villon a écrit la Ballade des Pendus en 1462.
- 3.) Une des principales formes de musique polyphonique franco-allemande des XIVe et XVe siècles.
 Ban
Ban
- nom masculin, de l'ancien francique ban.
- 1.) Proclamation solennelle émanant d'une autorité. Ouvrir et fermer le ban = battre le tambour ou sonner la trompe pour annoncer le début et la fin d'une proclamation officielle. Publier les bans = avertir d'un mariage ou d'une entrée sous les ordres. Ban de vendanges = autorisation des cueillettes. Pouvoir de ban.
- 2.) On appelle ban de four et de moulin, un droit en vertu duquel le seigneur d'un fief peut obliger ses vassaux à venir cuire au four banal, à moudre à son moulin.
- 3.) Mandement par lequel un seigneur convoque ses vassaux, généralement pour mener une guerre. Convoquer le ban et l'arrière-ban = ban est la partie la plus valide de la population (ou les vassaux directs), et arrière-ban la réserve composée des citoyens plus âgés, et qui ne doivent prendre les armes que dans les moments de grand péril (ou les arrière-vassaux).
- 4.) Exil imposé par proclamation, équivaut au bannissement. Mettre une ville, un prince au ban de l'Empire = dans la Constitution de l'Empire germanique, les déchoir de leurs privilèges.
- 5.) Amende, peine pécuniaire.
 Banalité
Banalité
- nom féminin, de ban. Obligation pour les gens d'une seigneurie de se servir des équipements du fief (moulin banal, four banal) contre redevance.
 Bande
Bande
- nom féminin.
- 1.) En héraldique, pièce honorable de l'écu, posée diagonalement de l'angle dextre du chef à l'angle senestre de la pointe. Elle symbolise le baudrier du cavalier. Elle est plus large que la barre et occupe un emplacement précis sur le blason (voir VI Héraldique)
- 2.) du francique binda (lien). Parties de métal qui maintiennent les arçons et forment le côté de la selle.
- 3.) du germanique bandwa (étendard). Groupe d'hommes qui combattent ensemble. Troupe d'animaux (perdreaux...).
 Bandé,
Bandée
Bandé,
Bandée
- adjectif, de bande. En héraldique, se dit d'un blason couvert de bandes (voir VI Héraldique)
 Banneret
Banneret
- nom masculin et adjectif, de bannière.
- 1.) Chevalier qui a le droit d'arborer une bannière au combat, de regrouper ses vassaux en une unité et de les diriger. Le banneret doit disposer des troupes nécessaires pour lever sa bannière au combat et la défendre, c'est à dire (selon les sources) entre dix et vingt-quatre gentilshommes montés, chacun accompagné d'un sergent et d'un écuyer. Le banneret reste d'un rang inférieur aux nobles (duc, comte, baron, prélat) mais il dispose néanmoins d'une situation économique ou sociale souvent supérieure à la leur, sa qualité de banneret lui venant de sa capacité financière à entretenir des troupes. Un titre de noblesse devient alors un honneur qu'il peut briguer. Il existe aussi des écuyers bannerets, qui tout en ayant le fief et le nombre requis de vassaux, ne sont pas encore adoubés chevaliers.
- 2.) En héraldique, on appelle vol banneret le vol placé au dessus du cimier et coupé sur le dessus en carré, comme une bannière (voir VI Héraldique)
 Bannière,
Bannières
Bannière,
Bannières
- nom féminin, de ban.
- 1.) singulier. Enseigne ou drapeau autour duquel se regroupent les vassaux rassemblés par le ban. La bannière est obtenue en coupant les pointes (ou cornettes) de l'étendard du chevalier simple, la rendant ainsi carrée. La première bannière connue est l'oriflamme de saint Martin de Tours, qui fut le premier étendard des Français, après la conversion de Clovis.
- 2.) singulier. En héraldique, les armes en bannière, c'est à dire en carré et arborant la qualité du banneret, sont plus honorables que les armes en écusson, c'est à dire en pointe.
- 3.) pluriel. Recueil ou registre pour l'enregistrement de toutes les ordonnances et lettres patentes adressées au Châtelet, et pour tous les autres actes dont la mémoire doit être conservée. Les Bannières sont les registres des publications, et sont séparées des registres des audiences. Ils furent commencés en 1461 par Robert d'Estouteville, Prévôt de Paris.
 Banquelet
Banquelet
- nom masculin. Élément métallique de forme rectangulaire que l'on rive par ses extrémités pour la décoration d'une ceinture.
 Baptême
Baptême
- nom masculin. Sacrement chrétien, le premier des sept sacrements de l'Église catholique, qui donne l'accès aux autres sacrements. Il se confère par immersion totale ou par simple ablution sur le front.
 Barbacane
Barbacane
- nom féminin, de l'arabe barbakh (tuyau) et khanêh (écoulement).
- 1.) Ouverture haute et étroite dans les murs de soutènement qui permet l'aération ainsi que la circulation de l'eau. On l'utilise particulièrement pour les ouvrages soumis aux inondations ou pour les terrasses.
- 2.) Ouvrage de fortification avancé qui protège une porte ou un pont. (voir V Habitations - Fortifications)
 Barbarin
Barbarin- nom masculin, de barbarinus. Monnaie que les vicomtes de Limoges font battre au XIIIe siècle. Vraisemblablement d'origine arabe durant leur domination de l'Espagne, elle est introduite en France sous les Carolingiens et les marchands l'acceptent, ce qui entérine son usage. Cette monnaie est citée en 1211 dans la Chronique de saint Martial de Limoges et en 1263 dans celle de saint Etienne de Limoges.
 Barbet
Barbet- nom masculin, de barbe. Chien d'eau, du style griffon à poils longs et frisés, généralement dressé pour la chasse au canard. Il mesure environ 55 à 60 centimètres au garrot.
 Barbute
Barbute- nom féminin, de barbe.
- 1.) Capuchon religieux, laïque et militaire, sorte d'aumusse du XIVe siècle qui habillait la tête et ne découvrait que le visage.
- 2.) Casque léger et sans visière, laissant le visage à découvert.
- 3.) Masque fait d'une étoffe terminée en pointe, percée de deux trous pour les yeux et qui couvre le visage. Au Moyen Age, les lépreux étaient tenus de porter une barbute.
 Barde
Barde
- nom masculin, du latin bardus. Poète celte qui célèbre les héros en musique. En Gaule et en Irlande, les bardes forment de véritables confréries.
 Bardé, Bardée
Bardé, Bardée
- 1.) nom féminin, de barda (bât, charge). Armure faite de lames métalliques et que l'on utilise pour protéger le poitrail et les flancs des chevaux de guerre.
- 2.) adjectif. En héraldique, se dit d'un cheval caparaçonné (voir VI Héraldique).
 Baron,
Baronnie
Baron,
Baronnie
- nom masculin, du francique baro (homme libre).
- 1.) Grand seigneur du royaume.
- 2.) Possesseur d'un fief avec un titre de baronnie. Immédiatement inférieur au marquis, il se place au dessus du chevalier.
 Barre
Barre
- nom féminin, du latin médiéval barra (barrière).
- 1.) En héraldique, pièce honorable de l'écu, posée diagonalement de l'angle senestre du chef à l'angle dextre de la pointe de l'écu. La barre est plus étroite que la bande et peut être placée à n'importe quel endroit de l'écu (voir VI Héraldique).
- 2.) En fauconnerie, les bandes noires qui traversent la queue des éperviers.
- 3.) En vénerie, on appelle armes de barre les défenses du sanglier.
 Barré,
os barré, frère barré
Barré,
os barré, frère barré
- adjectif, de barre.
- 1.) En héraldique, se dit d'une pièce ou d'un écu qui présente une barre. La barre est rarement utilisée comme pièce, mais elle sert souvent de brisure aux enfants naturels et leurs descendants (voir VI Héraldique)
- 2.) En médecine médiévale, on nomme os barré l'os (!) qui s'ouvre lors de l'accouchement. Le nom moderne est la symphyse pubienne, qui rend certains accouchements plus laborieux et donne au toucher l'impression de la présence d'une barre.
- 3.) Ancien nom des Carmes, que l'on appelle Frères Barrés, parce qu'ils portent un habit barré, bigarré de blanc et de noir. Le choix de ces couleurs obéit évidemment à une décision historique. Après s'être rendus maîtres de la Terre Sainte, les Sarrasins défendent à tous ceux de l'ordre des Carmes de porter des capuches blanches, ou tout autre habit blanc, car le blanc représente pour eux une marque de distinction et de noblesse. Les Carmes sont contraints de suivre la coutume des Orientaux et ils adoptent des manteaux bariolés. Vers 1285, de retour en Occident avec ces vêtements, on les appelle les Frères Barrés, nom qui va rester à une rue du quartier saint Paul à Paris, où ils prennent leur première maison, jusqu'à leur implantation place Maubert, sous le règne de Philippe le Bel. Par la suite, les religieux reprennent leurs premiers habits blancs. Il y a eu parfois des gens d'église qui portaient encore des habits bigarrés, mais le concile de Vienne a défendu aux ecclésiastiques de tels coloris.
 Bassinet
Bassinet- nom masculin, de bassin.
- 1.) Partie creuse de la platine d'une arme à feu, dans laquelle on place l'amorce.
- 2.) Armure de tête. A l'origine, c'est une calotte de fer que l'on porte sous le casque. Puis vient le grand bassinet à partir du XIVe siècle, de forme ovoïde. Après l'ajout de pièces de métal protégeant le cou et les joues, il remplace progressivement le grand heaume du XIIIe siècle. A partir de la seconde moitié du XIVe, on lui adjoint une visière mobile.
- 3.) A méditer : l'expression cracher au bassinet (donner de l'argent à contrecoeur) admet comme synonyme moderne : casquer...
 Bastage
ou Bâtage
Bastage
ou Bâtage
- nom masculin, de bât. Droit de péage que certains seigneurs prélèvent pour les chevaux de bât, chargés ou non, en plus du droit de passage.
 Bastille
Bastille
- nom féminin, de bastide.
- 1.) Château fort construit à Paris par Charles V à partir de 1369 et terminé sous Charles VI en 1383. Plutôt utilisée comme prison d'état, la Bastille semble être le seul monument ayant gardé ce nom. Symbole de la Révolution française, elle est prise d'assaut le 14 juillet 1789 et démantelée la même année.
- 2.) Ouvrage temporaire construit par des assiégés pour défendre leurs fortifications ou placé autour d'une place forte par l'assaillant lors d'un siège. Ne possédant pas assez de troupes pour encercler efficacement la ville, cette tactique est adoptée par les Anglais en 1428 lors du siège d'Orléans.
 Bastillé,
Bastillée
Bastillé,
Bastillée
- adjectif, de bastille. En héraldique, pièce garnie de créneaux dirigés vers la pointe de l'écu, par opposition à crénelé (voir VI Héraldique)
 Bastillon
Bastillon
- nom masculin, de bastille. Tour destinée à l'artillerie, en saillie sur la courtine et qui dispose d'embrasures pour le tir des armes à feu.
 Bastion
Bastion
- nom masculin, de bastille. Ouvrage avancé de fortification faisant saillie de l'enceinte. Souvent en forme de pentagramme, un côté est soudé à la courtine (la gorge), deux sont tournés vers le rempart (les flancs) et les deux derniers orientés vers l'extérieur (les faces). D'abord appelés boulevards, ils sont principalement utilisés à partir de 1500-1520, c'est à dire en dehors de notre période de référence. Ils répondent aux nouvelles exigences des fortifications après l'avènement de l'arme à feu, qui veut que chaque partie de l'enceinte doit être défendue à partir d'une autre. Vauban sera un virtuose de son implantation.
 Battue
Battue
- nom féminin, de battre. Terme de chasse. Rassemblement de gens qui battent les bois et les taillis en faisant du bruit pour en faire sortir les animaux.
 Baudequin
Baudequin- nom masculin, de baldaquin. Petite monnaie française au début du XIVe siècle, d'une valeur de six deniers. Un titre de la Cour des Comptes indique que les monnayeurs demandèrent sa suppression en 1308. Son nom vient de ce que le roi y était représenté sur un trône, sous un baldaquin.
 Bauge
Bauge
- nom féminin. Gîte bourbeux et fangeux de certains animaux, particulièrement du sanglier. Synonyme : souille.
 Bavière
Bavière
- nom féminin, de baver. Pièce d'armure de fer destinée à protéger le cou et le menton de l'homme d'armes, car les heaumes du XIIe et du XIIIe siècles ne suffisent plus. Sous le règne de Charles VII au début du XVe siècle, la mentonnière est élevée jusqu'au dessus des narines, avec une projection vers l'avant suffisante et des ouvertures pour faciliter la respiration. Avec une protection de tête du type de la salade, la bavière est fixée à la partie supérieure de la cuirasse. Quand il s'agit de l'armet, la bavière fait partie du casque et est mobile autour des mêmes pivots que le mézail (voir II Armement - Armures)
 Bec
de corbin
Bec
de corbin
- nom masculin, de bec de corbeau. Arme contondante comparable à une masse, qui comporte un ergot en forme de bec capable de percer une cuirasse. On peut ajouter une pointe métallique à l'extrémité du manche (voir II Armement - Armes de main)
 Beffroi
Beffroi- nom masculin. Tour d'attaque mobile. Les assiégeants lui donnent une hauteur supérieure aux murailles qu'ils souhaitent attaquer, afin de dominer les défenseurs et les prendre sous leurs tirs. Elle peut être montée sur roues, ou construite sur une barge et est poussée par l'assaillant contre l'enceinte d'un château. Souvent dotée de plusieurs étages, elle renferme des troupes qui vont tenter de déborder la garnison. Dès lors que l'artillerie suffit à créer des brèches dans les murailles, le beffroi disparaît (voir II Armement - Siège)
 Béjaune
Béjaune
- nom masculin, de bec et jaune. En fauconnerie, jeune oiseau inexpérimenté. Il porte une membrane jaune sur le bec avant d'avoir toutes ses plumes et de pouvoir voler, d'où son nom.
 Bénédiction
Bénédiction
- nom féminin, du latin ecclésiastique benedictio.
- 1.) Grâces et faveurs accordées par Dieu.
- 2.) Action du prêtre qui bénit l'assemblée des fidèles, un bâtiment, une cloche... par un signe de croix et des prières.
 Berme
Berme
- nom féminin, de l'allemand Brame (lisière). Espace étroit laissé entre le fossé et le pied du rempart pour recevoir les débris de la muraille et éviter de combler le fossé. On a coutume de palissader la berme ou la protéger par une haie vive, ce qui rend une tentative d'escalade plus difficile. On lui donne également le nom de relais, retraite, lisière ou pas de souris.
 Besant
Besant
- nom masculin, du latin byzantium.
- 1.) Monnaie byzantine d'argent ou d'or répandue au temps des croisades. On trouve des références à cette monnaie dans la Chanson de Roland ou Lancelot du Lac, la rançon exigée pour la libération de Saint Louis est de deux cents mille besants. Son poids et sa valeur ont varié selon les lieux et les époques. Le besant d'or a été fabriqué sous les rois des première et deuxième races, il disparaît sous Charles VI.
- 2.) En héraldique, cercle d'or ou d'argent qui représente une pièce de monnaie sans aucun marquage. Il symbolise le voyage effectué en Orient ou en Terre Sainte. Ne pas confondre avec le tourteau qui est de couleur (voir VI Héraldique)
 Bête
Bête
- nom féminin.
- 1.) En vénerie, nom du gros gibier que l'on chasse à cor et à cri. Les bêtes fauves regroupent les daims, les cerfs, les chevreuils ainsi que les biches et les faons. Les sangliers, laies et marcassins sont les bêtes noires. Renards, blaireaux, fouines et putois forment le groupe des bêtes puantes, tandis que les loups et les renards, et de nouveau les blaireaux, fouines et putois sont appelés bêtes rousses ou carnassières.
- 2.) Nom donné par les protestants à Rome, à l'Église romaine, qu'ils comparent à la bête de l'Apocalypse. Dans toutes les interprétations des protestants, les Vaudois, les Albigeois, les hérésiarques Wiclef et Jan Hus se considèrent comme de fidèles témoins de la vérité, persécutés par la bête.
 Bienheureux
Bienheureux
- adjectif du vocabulaire religieux, de bien et heureux. Personne à qui l'Église catholique reconnaît la perfection chrétienne en autorisant qu'on lui rende un culte local et le déclare être du nombre de ceux qui jouissent de la gloire éternelle. La béatification est la reconnaissance officielle de ce statut. Dans la hiérarchie, le bienheureux se situe au dessus du vénérable, mais après le saint. La béatification est l'acte solennel qui précède ordinairement la canonisation.
 Bien
Public, ligue du Bien Public
Bien
Public, ligue du Bien Public- 1465, ligue de grands du royaume constituée contre Louis XI.
- La politique de Louis XI atteint les privilèges des nobles, soumet l'Eglise à la fiscalité, augmente les impôts du peuple et des bourgeois. Les grands seigneurs du royaume réclament la convocation des états généraux, l'allègement des impôts et la suppression des aides. Le duc de Berry, frère du roi, mène la conjuration, suivi de Dunois, Chabannes, des ducs d'Alençon, de Bourbon, de Lorraine et de Bretagne, ainsi que du puissant comte de Charolais et duc de Bourgogne, le futur Charles le Téméraire. Le peuple ne suit pas, ni la petite et moyenne noblesse, ni la bourgeoisie, le bas et moyen clergé non plus. Louis XI s'allie au duc de Milan et aux Liégeois. Après plusieurs batailles très indécises, les traités de Conflans et de Saint Maur sont signés. Louis XI semble avoir beaucoup perdu, mais les traités ne servent qu'à disperser les conjurés. La Ligue du Bien Public est dissoute. Louis XI profite alors de l'isolement de chacun pour reprendre petit à petit ce qu'il a concédé.
 Billette
Billette
- nom féminin, du bas latin bilietum (bille).
- 1.) En héraldique, pièce de la forme d'un losange. On trouve également des billettes couchées ou renversées. L'écu est dit billeté (voir VI Héraldique)
- 2.) Morceau d'étoffe en losange, d'or, d'argent ou de couleur, que l'on coud sur les habits à intervalles réguliers pour leur servir d'ornement.
- 3.) En architecture, ornement composé de petits tronçons de tore espacés. Les billettes sont très employées dans le style roman.
- 4.) Petit billot de bois que le seigneur péager est tenu de suspendre à une potence en signe de son droit et pour avertir le passant qu'il doit s'arrêter pour payer le péage.
 Billon,
monnaie de billon
Billon,
monnaie de billon- nom masculin, de bille.
- 1.) Dans le vocabulaire des monnaies, pièce de cuivre mêlée ou non d'argent, comme le sou par exemple. On appelle aussi monnaie de billon les pièces de faible valeur ou défectueuses.
- 2.) Alliage ou mélange de métaux dont la composition (teneur en cuivre) ne permet plus la fabrication des pièces selon les ordonnances relatives au titre des monnaies. Une pièce d'or doit titrer vingt-deux carats, une d'argent onze deniers. Un billon d'or ne titre que vingt-et-un carats ou moins. Il existe deux billons d'argent : le Haut Billon contient entre cinq et dix deniers de fin, le Bas Billon contient moins de cinq deniers, tels les douzains.
 Blanc
Blanc- nom masculin. Nom d'une monnaie de billon créée sous Philippe VI de Valois, communément appelée à l'époque gros tournois, puisqu'elle le remplaçait. Sa valeur de base est de dix deniers tournois et on la nomme souvent grand blanc ou gros denier blanc. Il existe aussi une variante valant seulement cinq deniers baptisée petit blanc. En 1358 (règne de Jean II le Bon), on fabrique de gros deniers blancs à la couronne. Pendant la guerre de Cent Ans, il existe des blancs à la couronne d'une valeur de douze deniers, à cause des différences de change. Sous le règne de Charles VI, on fabrique des blancs et des demi-blancs à l'écu, puis des grands blancs au soleil sous Louis XI. Sous Charles VIII, on frappe des sous d'une valeur de treize deniers, le treizain ou Carolus Francicus. Avec Louis XII, il devient le Ludovicus. Enfin, on connaît l'existence des Nesles, qui auraient été frappés dans la tour de Nesle à Paris, autrement appelés sous ou livres blancs.
 Blason
Blason
- nom masculin, vraisemblablement de l'allemand blasen (sonner du cor).
- 1.) Petite pièce en vers contenant l'éloge ou le blâme du sujet qui peut être une personne ou un objet. Cette composition laisse le champ ouvert à la malice des poètes. Surtout en vogue aux XVe et XVIe siècles, le blason change de nom par la suite mais ne disparaît pas. On en connaît un grand nombre, généralement très licencieux. Clément Marot (1496-1544) a écrit Le blason du beau et du laid tétin. Jean de la Taille (1540-1608) a écrit le Blason de la Rose.
- 2.) Ensemble des pièces qui constituent un écu héraldique. Il ne faut pas confondre les armes et le blason. Les armes représentent des devises ou des figures dont l'écusson est chargé, alors que le blason est la description que l'on en fait verbalement (voir VI Héraldique)
 Bliaud
ou Bliaut
Bliaud
ou Bliaut
- Nom masculin. Tunique aux manches étroites, portée au Moyen Age par les hommes et les femmes. On le porte par dessus le chainse et serré à la taille par une ceinture. Certains personnages de la Tapisserie de la Reine Mathilde sont vêtus d'un bliaud. On trouve encore son dérivé blaude (nom féminin) dans l'est et en Provence pour désigner une blouse.
 Blocage
Blocage
- nom masculin. Un mur de fortification n'est pas construit en un seul bloc homogène. Deux murs parallèles sont montés, les parements, et l'on remplit l'intervalle avec un mélange grossier de cailloux et de mortier, le blocage.
 Bogomile
Bogomile
- nom masculin et adjectif, du bulgare Bog (Dieu) et milui (ayez pitié), signifie celui qui implore la miséricorde de Dieu. Membre d'une secte hérétique qui existe entre le Xe et le XIIIe siècle. Leur doctrine se rapproche des manichéens. Ils nient le mystère de la Sainte Trinité et la résurrection, soutiennent que Dieu a une forme humaine, que le monde a été créé par les mauvais anges et que l'archange saint Michel s'est incarné. Ils rejettent les livres de Moïse, considèrent le culte des images comme une idolâtrie, la messe comme un sacrifice de démons et la Croix comme l'instrument de la mort du Sauveur. Leur chef Basile est brûlé vif sur ordre de l'empereur byzantin Alexis Comnene.
 Bombarde
Bombarde
- nom féminin, probablement de l'allemand bomberden, pluriel de bomber (baliste). Au Moyen Âge, machine de guerre qui sert à lancer des boulets ou de grosses pierres, selon la technique des mortiers actuels. Après l'adoption de la poudre à canon, on donne ce nom à quelques-unes des premières pièces d'artillerie.
 Bonnet
pointu
Bonnet
pointu
- nom masculin. Coiffure féminine en forme de cône allongé incliné vers l'arrière, à laquelle on suspend un voile.
 Bonnette
Bonnette
- nom féminin, de bonnet. Ouvrage de fortification avancé au-delà du fossé, et dont les deux faces forment un angle saillant. On l'appelle aussi flèche.
 Bonté
Bonté- voir Titre.
 Bordure
Bordure
- nom féminin. En héraldique, pièce honorable d'une couleur différente de l'émail, qui occupe le pourtour intérieur de l'écu. D'une largeur d'environ un sixième, elle permet de distinguer les différentes branches des enfants puînés (voir VI Héraldique)
 Bouclier
Bouclier
- nom masculin, du latin bucularium (boucle). Arme défensive portée au bras gauche, qui protège une partie du corps contre les coups adverses. Il est construit sur la base d'une plaque en bois. Il peut être couvert de plusieurs épaisseurs de peaux, renforcé de boucles ou de bosses métalliques, voire garni de pointes extérieures. Il est équipé de lanières sur l'intérieur pour le maintien. Sa fonction principale est de détourner le coup plutôt que de bloquer l'arme de l'adversaire (voir II Armement - Armures)
 Bourgeois
Bourgeois- nom masculin, de bourg.
- 1.) Dans un bourg ou une cité, citoyen qui jouit de certains privilèges ou occupe un certain statut social. Le bourgeois n'appartient pas au clergé, n'est pas noble, il possède des biens et n'exerce aucune activité manuelle.
- 2.) Monnaie de billon créée sous le règne de Philippe le Bel. On distingue les bourgeois simples qui correspondent aux deniers parisis des bourgeois doubles qui correspondent aux doubles parisis. On connaît également les petits bourgeois, les forts bourgeois et les doubles forts bourgeois.
 Bourgeois
de Calais
Bourgeois
de Calais- Le roi de France abandonne Calais à Édouard III d'Angleterre le 2 août 1347. Des pourparlers sont entamés pour négocier la reddition de la ville, pourparlers que le roi d'Angleterre accepte à condition que six bourgeois de Calais viennent nu-pieds, en chemise et la corde au cou, lui offrir les clefs de la ville et attendre qu'il décide de leur sort. Les six hommes s'appellent Eustache de Saint Pierre, Jean d'Aire, André d'Ardres, Jean de Fiennes et les frères Jacques et Pierre de Wissant. Édouard III songe à les faire mettre à mort, mais sa femme Philippine de Hainaut réclame leur grâce et l'obtient. La ville est alors épargnée. Les six Bourgeois sont envoyés en Angleterre, puis libérés contre rançon. Auguste Rodin a sculpté en 1889 la statue des Bourgeois de Calais qui se dresse depuis 1895 sur la place du Soldat-Inconnu.
 Bourguignons,
faction des Bourguignons
Bourguignons,
faction des Bourguignons- Durant la guerre de Cent Ans, sous le règne de Charles VI et de Charles VII, faction alliée aux Anglais qui s'oppose au parti des Armagnacs dans une guerre civile. Son chef, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, profite de la folie de Charles VI et veut exercer le pouvoir en France en 1407. Il laisse les Anglais écraser l'armée française composée principalement d'Armagnacs à Azincourt en 1415. Le traité d'Arras en 1435 met fin à la guerre civile. Les Bourguignons prennent pour symbole un chaperon vert.
 Bourrer
Bourrer
- verbe intransitif, du latin burra (poil, fourrure). Dans le vocabulaire de la chasse, en parlant d'un chien : courir après un gibier (lièvre) au lieu de rester à l'arrêt et lui arracher du poil.
 Bourse
Bourse
- nom féminin, du bas latin bursa (cuir). Dans le vocabulaire de la chasse, poche ou filet que l'on place devant les sorties d'un terrier pour prendre le lapin qu'on chasse au furet.
 Bouteroue
Bouteroue
- nom féminin (Académie Française, Bescherelle...) ou masculin (Journal Officiel de Genève...) selon les sources, de bouter et roue. Terme d'architecture qui désigne plus précisément les saillants de pierre placées aux angles des maisons ou des garde-fous sur les ponts, pour éviter que les essieux des voitures ne les détériorent. Le terme de borne est impropre, étant donné qu'elles ne servent pas à délimiter une propriété.
 Braconner
Braconner
- verbe intransitif, du haut allemand bracco (chien de chasse). Chasser ou pêcher sans autorisation, à une période ou en un lieu interdits ou à l'aide d'engins prohibés.
 Braconnière
Braconnière
- nom féminin, du latin bracae. Pièce d'armure de plates constituée de lames métalliques qui protègent le ventre et le haut des cuisses jusqu'aux genoux. L'ensemble est fabriqué sur une toile légèrement matelassée et garnie de mailles sous le plastron, aux emplacements des rotules et au creux des genoux. La braconnière est également appelée jupe de plates.
 Braie,
Braies, Fausse-Braie
Braie,
Braies, Fausse-Braie
- 1.) nom féminin pluriel, du latin bracae. Pantalon ample porté depuis les Gaulois et les Germains.
- 2.) nom féminin. Enceinte installée sur la contrescarpe, qui entoure tout ou une partie de l'enceinte principale du château, aménagée au niveau de l'escarpe afin de surélever celle-ci et de protéger la base des murailles principales contre les projectiles et contre la pose directe d'échelles par l'assaillant (voir V Habitations - Fortifications)
 Brame
ou Bramement
Brame
ou Bramement
- nom masculin, du gothique bram (grand cri). Cri du daim ou du cerf en rut. En dehors de cette période, le cerf rée (verbe réer ou raire).
 Braque
Braque
- nom masculin, du haut allemand bracco (chien de chasse). Chien de chasse à poil ras et à oreilles pendantes; très bon chien d'arrêt, réputé pour la qualité de son odorat. Parmi les variétés, on compte le chien courant et le basset.
 Brassard
Brassard
- nom masculin, du latin braccio (bras), dérivé de brassal. Pièce d'armure qui recouvre le bras, articulée afin de libérer le mouvement du coude. Le Gendre cite les brassards vers l'an 1300 en complément des cuissards, jambières et gantelets.
 Bretèche
ou Bretêche ou Bretesse
Bretèche
ou Bretêche ou Bretesse- nom féminin, du latin médiéval brittisca.
- 1.) Ouvrage de fortification muni de créneaux et en avancée sur une façade (voir V Habitations - Fortifications)
- 2.) Balcon en bois placé sur la façade de certains édifices (hôtels de ville...) à partir du XVe siècle.
- 3.) Terme de blason. Rangée de créneaux sur une fasce, une bande ou un pal, ou sur les côtés de l'écu (voir VI Héraldique)
 Brigandine
Brigandine
- nom féminin, de brigand (au sens de soldat à pied). Armure de corps faite de lames de métal jointes et clouées ou rivées les unes sur les autres. Les plates sont fixées sur la base d'un pourpoint et souvent recouvertes d'un autre vêtement. La brigandine protège généralement le torse, souvent les bras. Plus souple et moins coûteuse qu'un haubert ou un plastron, elle est utilisée par les fantassins, archers et arbalétriers du XIVe jusqu'au XVIe siècle. Son nom lui vient des brigands, les soldats soudoyés par la ville de Paris dès 1356 pendant la captivité du roi Jean II en Angleterre. Equipés en hommes de pied avec ces armures, ils commirent de nombreux vols et pillages. On a alors baptisé brigands tous les voleurs de grand chemin. On connaît des représentations de la brigandine dès 1375 et elle est citée dans le détail de l'équipement des francs-archers créés sous Charles VII (règne de 1422 à 1461).
 Brisées
Brisées
- nom féminin pluriel, de briser. Dans le vocabulaire de la chasse, branches que le veneur rompt (sans les détacher de l'arbre) pour marquer la voie de la bête.
 Brisure
Brisure
- nom féminin, de briser. En héraldique, modification apportée à un écu pour distinguer la branche cadette de la branche aînée ou la branche bâtarde de la branche légitime. On ajoute généralement quelques pièces pour la distinguer des armes pleines d'un aîné. Le lambel, le bâton, le cotice, la bordure et les pièces dont on les charge sont des signes classiques de brisure. La brisure est héréditaire et ne cesse que lorsque la succession rend le droit de porter des armes pleines. A titre d'exemple, les familles d'Anjou, d'Orléans ou de Bourbon ont porté la brisure jusqu'à ce que leur rang de succession leur permette d'accéder aux pleines armes et à la couronne.
 Brocard
ou Broquart
Brocard
ou Broquart
- nom masculin, de broque (dague). Cerf ou chevreuil mâle, âgé d'un an à un an et demi, dont les bois ne sont pas encore ramifiés.
 Broches
Broches
- nom féminin pluriel, de broque (dague).
- 1.) Premiers bois du chevreuil, cités dans la Chasse de Gaston Phébus.
- 2.) Défenses du sanglier = dagues.
 Broigne
Broigne
- nom féminin, du slave brogne. Cuirasse portée entre deux tuniques, qui constitue l'équipement des Francs au IXe siècle. Au XIe siècle, la broigne est formée de plaquettes carrées, triangulaires, rondes ou imbriquées, cousues sur une tunique qu'on passe par-dessus les autres vêtements. Les pièces ne sont pas rivées entre elles, mais simplement fixées sur le vêtement de dessous. A l'époque de Philippe-Auguste, la broigne est un synonyme du haubert pour tout habit chevaleresque décrit par les poètes. Elle est pourtant abandonnée au milieu du XVe siècle au profit des armures à base de plaques de fer.
 Brosser
Brosser
- verbe intransitif. En vénerie, s'échapper en traversant taillis et broussailles.
 Bullaire
Bullaire
- nom masculin, du latin médiéval bullarium (bulle). Recueil des bulles, parchemins scellés de plomb, émises par les papes.
 Burèle
ou Burelle
Burèle
ou Burelle
- nom féminin, de l'ancien français burel (rayé). En héraldique, série de huit (ou dix selon les sources) bandes au minimum, en nombre pair, horizontales et de deux couleurs alternées. Si la série est impaire, le nom approprié est trangles et non plus burèles (voir VI Héraldique)
 Burgondes
Burgondes- Les Burgondes sont un peuple germanique qui participe aux migrations et invasions de la fin de l'Antiquité, période durant laquelle ils s'établissent durablement en Gaule. Au terme de migrations en Germanie et sur le plateau bavarois, les Burgondes établissent un royaume près de Worms au début du Ve siècle. Pris entre les Alamans au sud et les Francs au nord, ils restent en Rhénanie une trentaine d'années. Convertis au christianisme orthodoxe (catholicisme), puis à l'arianisme, ils rompent avec les Romains et se heurtent au général Aetius qui les défait. Une partie d'entre eux traverse alors le Rhin pour se mettre au service d'Attila. Les autres sont intégrés comme auxiliaires dans l'armée romaine et reçoivent alors le droit de s'établir en Savoie. Vers 500, les Burgondes ont étendu leur royaume vers l'Ouest et ce dernier est centré sur le Lyonnais et sur le Dauphiné. Le roi Gondebaud, a su éliminer ses trois frères pour concentrer le pouvoir entre ses mains. En plus de faire rédiger la Loi Gombette, il est aussi connu comme l'oncle de Clotilde, l'épouse catholique de Clovis. En 534, le royaume des Burgondes est finalement annexé par les Francs mérovingiens. Au Moyen-Age, la Bourgogne reprend dans son nom le souvenir de ce premier royaume.
 Calice
Calice
- nom masculin, du latin calix. Objet liturgique. Coupe contenant le vin du sacrifice eucharistique que le prêtre consacre en Sang du Christ pendant la messe. Les calices des apôtres et de leurs premiers successeurs étaient de bois. Selon les sources, c'est saint Zéphyrin (pontificat de 199 à 217) ou saint Urbain Ier (pontificat de 222 à 227) qui ordonna qu'on se serve de calices d'or ou d'argent. Pour sa part, saint Léon IV (pontificat de 847 à 855) a interdit les calices d'étain et de verre.
 Camail
Camail
- nom masculin, du latin caput (tête) et macula (maille).
- 1.) Protection de tête en mailles qui couvre également les épaules et la poitrine. Le camail est connu depuis les Carolingiens, ainsi que chez les Normands. Tout d'abord en cuir, il est ensuite renforcé de plaques de fer ou d'anneaux, puis directement fabriqué en mailles métalliques. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, il est porté avec le haubert. A partir du XIVe siècle, le heaume ne se pose plus sur la coiffe de mailles car il est mis directement sur la tête. Le camail se réduit alors à une bande qui enveloppe le cou, lacée sur les bords du bassinet. Il disparaît peu à peu durant le XVe siècle, progressivement remplacé par l'armure de plates.
- 2.) Habillement du clergé en hiver, couvrant la tête, les épaules, et allant jusqu'à la ceinture, pour des occasions de cérémonie. Le camail ecclésiastique n'apparaît qu'à partir du XVe siècle.
- 3.) Terme de blason. Espèce de lambrequin servant à couvrir le casque et l'écu des chevaliers.
 Camérier
Camérier- nom masculin, du latin camera (chambre). Premier officier de la chambre du pape ou d'un cardinal.
 Canon
Canon- nom masculin.
- 1.) de l'italien cannone (tube). Pièce d'artillerie servant à lancer des boulets ou autres projectiles lourds (voir II Armement - Siège)
- 2.) du grec kânon (règle). Collection des textes juridiques de l'Eglise, également recueil des décisions solennelles des conciles. Droit canon.
- 3.) du grec kânon (règle). Figure de chant qui fait se répéter les strophes à l'infini, les phrases étant décalées les unes par rapport aux autres.
- 4.) du grec kânon (règle). Ancienne mesure de capacité pour le vin égale à un huitième de pinte, soit environ 12 cl. D'où l'expression : boire un canon.
 Canton
Canton
- nom masculin. En héraldique, une des neuf pièces honorables des armoiries. C'est une partie carrée de l'écu, séparée des autres. Elle n'a aucune proportion fixe, quoiqu'elle doive être plus petite que le quartier. Elle représente souvent un neuvième de l'écu, et on l'emploie comme une addition ou une différence, pour marque de bâtardise (voir VI Héraldique)
 Caparaçon
Caparaçon
- nom masculin de l'espagnol capa (manteau). Armure et harnois dont les chevaux étaient équipés dans les batailles.
 Capitation
Capitation
- nom féminin, du bas latin capitatio (par tête). Impôt, taxe levée par individu. Les premières capitations sont imposées en France sous le nom de fouages, et elles ne durent qu'un an. On les nomme tailles sous Charles VII, dès lors qu'elles deviennent perpétuelles. En Dauphiné, la capitation s'appelle capage. En Angleterre sous Charles II, chaque homme à partir de quatorze ans et chaque femme à partir de douze ans doit payer l'impôt selon son statut social. Un duc verse cent livres, un marquis quatre-vingts livres, un baronet trente livres, un chevalier vingt livres, un écuyer dix livres et toute personne roturière douze deniers.
 Capitulaires
Capitulaires
- nom masculin pluriel, du latin médiéval capitularis (chapitre). Ordonnance d'un roi ou d'un empereur franc en matière civile ou ecclésiastique, rédigée en chapitres. On connaît entre autres les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve...
 Carat
Carat
- nom masculin, du grec keration (cosse du caroubier = petit poids). Unité de mesure en orfèvrerie et monnaie.
- 1.) Carat de fin : indice de pureté de l'or, chaque 1/24e d'or fin contenu dans une quantité de ce métal. L'or pur titre 24 carats, l'or à 18 carats n'en contient que 18/24e, soit 75 %. Au Moyen Age, l'or le plus pur que l'on puisse obtenir titre 23 carats 3/4, soit un respectable 98,96 % de fin.
- 2.) Carat de prix ou carat de poids : partie qui représente 1/24e de l'objet de référence.
- 3.) Unité de poids pour les pierres précieuses et les perles, qui vaut 0,2 gramme. On peut encore diviser un carat en quatre grains, soit 0,05 gramme.
 Carlin
Carlin
- nom masculin, de l'italien carlino, diminutif de Carlo (Charles Ier d'Anjou). Monnaie italienne qui a cours de la fin du XIIIe au XVe siècle, lorsque Charles Ier d'Anjou, le frère de Saint Louis est roi de Naples. Il existe des carlins d'or et d'argent.
 Carole
Carole
- nom féminin. Danse en rond du Moyen Age.
 Carolus
Carolus
- nom masculin, du latin Carolus (Charles). Monnaie de billon frappée sous Charles VIII, d'une valeur de dix deniers d'argent. Elle porte une croix couronnée d'une fleur de lis à ses quatre branches et est marquée de la lettre K pour le nom Karolus Francorum Rex. Bien que décriée dès l'avènement de Louis XII, elle est utilisée comme monnaie de compte jusqu'au XVIIIe siècle car il n'existe pas d'autre monnaie pour désigner la valeur de dix deniers. En dehors du Moyen Age, Henry III s'allie à la fin du XVIe siècle avec le roi Henri de Navarre, futur Henri IV. Ils refusent pourtant de livrer bataille à Charles, duc de Mayenne, parce qu'il est dit qu'il ne faut pas hasarder un double Henry contre un Carolus. Charles Ier, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande à partir de1625, fait frapper un gros Carolus en or, valant treize livres quinze sols.
 Carquois
Carquois- nom masculin, du persan terkech. Fourreau cylindrique que l'on porte à l'épaule et qui permet le transport des flèches et des viretons. Ne pas confondre avec l'archais.
 Carreau
Carreau- nom masculin, du latin populaire quadrelus (carré). Trait d'arbalète dont le fer en losange possède quatre pans (voir II Armement - Armes de jet)
 Cartulaire
Cartulaire- nom masculin, du latin médiéval chartularium (recueil d'actes). Recueil de chartes et autres documents officiels contenant la transcription des titres de propriété et privilèges temporels d'un chapitre, d'une église ou d'un monastère.
 Casemate
Casemate
- nom féminin.
- 1.) de l'italien casamata (maison basse). Emplacement fortifié, situé dans le flanc d'une muraille et prévu pour accueillir une ou plusieurs pièces d'artillerie, pour défendre la courtine et le fossé. Elle n'est généralement pas reliée au reste du château.
- 2.) du grec khasma (fossé, gouffre). Terme de chasse. Trou dans lequel les blaireaux et les renards tiennent tête aux bassets.
 Cathare
Cathare
- voir Albigeois.
 Catholicisme
Catholicisme
- nom masculin, du grec katholikos (universel). Religion chrétienne dans laquelle le pape exerce l'autorité en matière de dogme et de morale. L'appellation vient de Théodose le Grand, qui nomma catholiques les églises qui suivirent les préceptes du concile de Nicée, à l'exception des autres, afin de remarquer leur caractère universel et leur présence parmi toutes les nations.
 Ceinture
Ceinture- nom féminin, du latin cinctura (ceindre).
- 1.) Ruban, bande souple en tissu, en cuir, etc... dont on s'entoure la taille pour ajuster un vêtement. Elle peut être décorée, rehaussée de banquelets, de fils précieux ou de pierreries. Elle conserve une grande importance au plan esthétique.
- 2.) La Ceinture de la Reine est une taxe levée à Paris de trois ans en trois ans, destinée à l'entretien de la maison de la Reine. Autrefois appelée taille du pain et du vin (six deniers pour le pain, trois deniers pour le vin), elle a d'abord augmenté, puis on l'a étendue à d'autres denrées, comme le charbon. On retrouve son existence sur les Registres de la Chambre des Comptes en l'an 1339.
 Ceinturon
Ceinturon
- nom masculin, du latin cinctura (ceindre). Large ceinture solide, plus adaptée à des usages exigeants, comme la chasse ou le port d'armes. Sa principale qualité est sa robustesse.
 Célébrant
Célébrant
- nom masculin, du latin celebrare (célébrer). Prêtre ou prélat qui dit la messe, qui officie.
 Cendre
Cendre
- nom féminin, du latin cinis, cineris (cendre).
- 1.) Symbole religieux associé à la dissolution du corps (poussière). En 1091, le Concile de Bénevent ordonne à tous les fidèles, clercs et laïcs, hommes et femmes, de recevoir des cendres sur leur tête le premier jour de Carême, qu'il appelle jour des Cendres. A partir du XIIIe siècle, la liturgie catholique le remplace par une croix que le prêtre trace sur le front des fidèles.
- 2.) Egalement symbole de pénitence. Faire pénitence avec le sac et la cendre. Prendre le sac et la cendre était se revêtir aux yeux de tous d'un habit de pénitence, une façon de se reconnaître grand pécheur et de demander sa grâce et son pardon à l'Eglise et à Dieu. Prendre la cendre et le cilice signifie faire pénitence, se mortifier. L'origine de cette locution remonte aux Hébreux, qui mettaient de la cendre sur leurs têtes dans les désolations publiques.
 Cène
Cène
- nom féminin, du latin cena (repas du soir).
- 1.) Terme religieux catholique, qui désigne le repas que Jésus-Christ prit avec ses apôtres la veille de la Passion et au cours duquel il institua l'Eucharistie. Le cénacle est le nom de la pièce qu'ils occupaient.
- 2.) Chez les protestants, cérémonie du jeudi saint et communion sous les deux espèces.
- 3.) Après la Cène, Jésus lava les pieds de ses apôtres. On dit
que le pape, les rois, les princes, les prélats et autres dignitaires
religieux font la cène le jeudi saint, lorsqu'ils servent à manger à
treize pauvres, après leur avoir lavé
les pieds.
- 4.) Représentation artistique : les deux plus connues sont la Cène de Léonard de Vinci (peinte entre 1495 et 1497) et une Cène de Paul Véronèse (peinte en 1571, puis rebaptisée le Repas chez Levi à cause de l'Inquisition).
 Cens,
Censier
Cens,
Censier
- nom masculin, du latin census (recensement). Impôt foncier que le fermier paye au seigneur du fief. Le cens est imprescriptible, il n'est pas rachetable non plus. Le seigneur (dit aussi le censier) peut imposer d'être payé en nature (grain, volaille...) si le titre de fermage le précise. Il en existe plusieurs déclinaisons : le gros cens, le menu cens. Le surcens permet au seigneur de doubler, tripler et même plus la valeur de l'impôt. La croix de cens représente un paiement en monnaie car les pièces de l'époque portaient généralement une croix.
 Censure
Censure
- nom féminin, du latin censor (celui qui blâme). Peine ecclésiastique formulée après examen contre une opinion ou un texte. Il existe trois niveaux de censure qui sont par ordre croissant la suspense, l'interdit et l'excommunication. De tous temps, les rois de France se sont prétendus exempts et affranchis des censures de Rome. Aucun roi de la première race (les Mérovingiens) n'a été censuré. D'après le Dictionnaire de Trévoux et l'Encyclopédie de Diderot, le premier Carolingien en serait Lothaire II, excommunié en 863 par le pape saint Nicolas Ier le Grand suite à la répudiation de sa femme légitime Theutberge. Et encore, le pape ne l'affronte pas seul, il se retranche derrière la confirmation de l'assemblée des Evêques de France. Le pape Urbain II conserve la même procédure contre Philippe Ier en 1094, après la répudiation de Berthe de Hollande, puis l'enlèvement et le mariage avec Bertrade de Montfort, déjà mariée à Foulques d'Anjou. A son tour, Philippe Auguste est excommunié selon les mêmes formalités. Par la suite, les rois de France ont inversé le rapport de force. Ainsi, lorsque le pape Benoît XIII censure Charles VI et place le royaume en interdit, le Parlement de Paris ordonne en 1408 que la bulle soit lacérée. Et lorsque le pape Jules II excommuniera Louis XII, l'Assemblée générale de Tours censurera la censure du pape.
 Cercle
Cercle- nom masculin, du latin circulus. Nommé Kreis en allemand, division administrative du saint empire romain germanique. Les cercles sont au nombre de quatre en 1387 et de dix en 1512 (Autriche, Bavière, Souabe, Franconie, Haute-Saxe, Basse-Saxe, Westphalie, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Bourgogne). Cette division est abrogée en 1806 par la Confédération du Rhin, puis reprise sous le IIIe Reich comme subdivision territoriale du Gau.
 Cérémonial
Cérémonial
- du latin caerimonialis (cérémonie).
- 1.) adjectif. qui a rapport avec les cérémonies religieuses. Le pluriel est cérémoniaux.
- 2.) nom masculin. Ensemble de formules, de règles de politesse et de courtoisie. On peut alors parler de code, d'usage. En termes politiques, il devient le protocole ou l'étiquette. Il peut différer d'un pays à un autre, voire même d'une cour à une autre. Le Littré le considère sans pluriel.
- 3.) nom masculin. Livre contenant les règles liturgiques des cérémonies ecclésiastiques, on parle alors de rituel. Le pluriel donne des cérémonials, et le Littré ne reconnaît pas cette acception.
 Cerf
Cerf
- nom masculin, du latin cervus (cerf).
- 1.) Terme de chasse. Grand mammifère herbivore ruminant de la famille des cervidés qui vit dans les forêts. Il fait partie des bêtes fauves. Le mâle adulte porte des bois ramifiés, d'autant plus grands qu'il est âgé et qui se renouvellent chaque année avant la période du rut. La femelle s'appelle la biche. Le jeune mâle prend différents noms selon son âge : faon jusqu'à un an, puis daguet la deuxième année, enfin le nombre de ramifications de ses bois indiquera son âge. Un dix-cors est un animal de sept à huit ans.
- 2.) En héraldique, le cerf est toujours de profil. Il est représenté passant ou courant. Debout, on le nomme élancé, couché sur ses jambes et le ventre à terre se nomme en repos. Lorsque le bois est d'un émail différent, on le dit ramé. Si la tête est séparée du corps, on la nomme rencontre et on peut en trouver plusieurs sur un même écu. Enfin, un massacre est une ramure entière, attachée sur une partie de l'os du crâne.
 Cervelière
Cervelière
- nom féminin, de cervelle. Armure de tête ouverte, en maille ou en métal, qui coiffe la partie supérieure du crâne. Le Dictionnaire de Trévoux attribue son invention à un certain Michel Scotus, domestique et astrologue, fort aimé de Frédéric II (empereur de 1220 à 1250). La cervelière est portée sous le grand heaume vers la fin du XIIIe et le début du XIVe siècles. Ensuite, ce casque évolue vers la forme du bassinet. On continue à l'utiliser lors des joutes.
 Chainse
Chainse
- nom masculin. Longue tunique en lin tombant jusqu'aux pieds, portée sous les autres vêtements. Dans le Glossaire des Poës du Roi de Navarre, on le trouve au féminin.
 Chair
Chair
- nom féminin, du latin caro, carnis (chair).
- 1.) Partie musculaire, molle et comestible de certains animaux, gibiers, poissons etc... qui est consommée.
- 2.) En fauconnerie, un animal bien à la chair est un oiseau qui chasse avec ardeur, qui chasse bien.
- 3.) Dans le vocabulaire religieux, la nature humaine (opposée à la nature divine), le corps (opposé à l'esprit, à l'âme).
 Chaire
Chaire
- nom féminin, du latin cathedra (siège à dossier).
- 1.) Siége élevé d'où l'on parle, enseigne ou commande. Plus particulièrement, espèce de tribune à dais d'où le prêtre adresse la parole aux assistants.
- 2.) Siège d'un pontife dans le choeur d'une église. Par extension, la dignité pontificale, la chaire de saint Pierre.
- 3.) Tribune d'un professeur dans une école publique, une université.
 Chaleur
Chaleur
- nom féminin, du latin calor. Terme de vénerie. Désir des femelles de certains mammifères pour le mâle. Pour les scientifiques, la période des chaleurs "se prend encore pour cette révolution naturelle qui arrive dans l'animal, en conséquence de laquelle il est porté à s'approcher par préférence d'un animal de la même espèce et d'un autre sexe, et à s'occuper de la génération d'individus semblables à lui" (extrait de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert).
 Chalumeau
Chalumeau
- nom masculin, du latin calamus (roseau).
- 1.) Terme religieux. Dans la liturgie catholique, tuyau en or dont se sert le pape à la communion pour la distribution du sang du Christ.
- 2.) Pour les alchimistes, tube utilisé pour diriger la flamme d'une lampe ou d'une chandelle au moyen d'un courant d'air sur l'objet que l'on veut chauffer.
- 3.) Terme de chasse. Petite branche que l'on recouvre de glu pour prendre les petits oiseaux.
- 4.) Instrument de musique, flûte champêtre et par extension, les instruments à vent qui composent la musique champêtre.
 Chamade
Chamade
- nom féminin, du latin clamare (appeler). Signal de tambours et/ou de trompes que donnent les assiégés pour avertir qu'ils souhaitent parlementer. Battre la chamade.
 Chambellan
Chambellan
- nom masculin, du franc kamarling (chambre). Gentilhomme de la cour chargé du service de la chambre du roi, de la reine ou d'un prince. Il fait également office de maître d'hôtel comme d'écuyer tranchant. Il jouit de nombreux privilèges en raison de sa proximité du seigneur. Le titre peut prendre la connotation de responsabilité des finances (le Grand Chambellan est le surintendant des finances du pape, tandis que le Chambellan du Sacré Collège est le cardinal qui administre les revenus du Sacré Collège) ou de la justice (le prévôt de Paris porte le titre de Chambellan ordinaire du roi).
 Champ,
champ de bataille, champ clos
Champ,
champ de bataille, champ clos
- nom masculin, du latin campus (plaine).
- 1.) Terme militaire. Champ clos : espace dégagé et clôturé par une enceinte ou une palissade, où se disputent les duels et les tournois. Champ de bataille : théâtre d'un affrontement particulier entre deux forces armées.
- 2.) En héraldique, le fond de l'écu, ensuite chargé des différentes pièces qui forment les armoiries (voir VI Héraldique)
 Champagne
Champagne
- nom féminin, du latin populaire campania (campagne). En héraldique, pièce honorable qui occupe le tiers inférieur de l'écu. Plutôt rare, elle est parfois confondue avec la plaine (voir VI Héraldique)
 Champart
Champart
- nom masculin, du latin campi pars (partie du champ). Impôt féodal en nature que le seigneur peut lever sur la récolte de ses tenanciers. Il peut ainsi prendre chaque dixième, douzième ou quinzième gerbe de la récolte. C'est l'équivalent de la dîme ecclésiastique (un dixième du revenu). On trouve aussi les appellations terrage ou agrier ou agrière.
 Champion
Champion
- nom masculin, du bas latin campium (champ de bataille). Volontaire, vassal ou mercenaire qui combat en champ clos pour défendre une cause, l'honneur ou les intérêts de son mandataire. Le recours à un champion est obligatoire pour les dames et les ecclésiastiques, autorisé pour les sexagénaires et les infirmes. Les puissants en utilisent aussi pour ne pas s'exposer personnellement. La victoire du champion prouve le bien-fondé de la cause défendue. Si le mandataire est noble, le champion porte une épée et un écu, mais seulement un bâton et un bouclier de bois pour un roturier. La chanson de Roland cite l'usage des champions. En 1231, on prévoit de trancher le poing ou le pied d'un champion défait, plus une amende, s'il n'est pas déjà mort au cours de l'affrontement. En Angleterre, le champion du roi est un homme armé de toutes pièces, qui entre à cheval dans la grande salle de Westminster et qui défie par la bouche d'un héraut quiconque oserait contester le droit du roi à la couronne.
 Chanfrain
ou chanfrein
Chanfrain
ou chanfrein
- nom masculin, du latin frenum (frein). Armure de fer ou d'acier qui protège le devant de la tête du cheval. On commence à l'introduire dans l'armement général du cheval au temps de Philippe le Bel, à la fin du XIIIe siècle et il est cité dans la Chronique du clerc Cuvelier vers 1380. Il se fixe directement sur le harnais et devient un support d'ornement très chargé à partir du XVe siècle. Ainsi, le comte de St Pol, accompagnant le roi à Rouen en 1449, "avoit un chanfrain à son cheval prisé trente mille écus" et le comte de Foix, à son entrée dans Bayonne en 1451, "avoit au cheval qu'il montoit un chanfrain d'acier garni d'or et de pierres précieuses prisées quinze mille écus" (cité de l'Histoire de Charles VII). Une dernière description du XVe siècle : "Un chanfrain de cheval sur velours noir, de fil d'or de brodure (broderie), garni de huit grans tables de balays (sorte de rubis) et d'un gros cabochon de balay et cent et douze perles branlans", sans oublier les plumets "sur leurs testes chacun un très bel chanffrin d'acier bien garni de très belles plumes d'ostrusse (d'autruche)". Durant un tournoi, on utilise un chanfrein dont les ouvertures sont aveuglées afin que le cheval ne dévie pas de sa trajectoire lors de la charge.
 Change
Change
- nom masculin, de l'italien cambio (changer).
- 1.) Terme financier. Conversion d'une monnaie contre une autre monnaie, une valeur monétaire contre une valeur équivalente.
- 2.) Terme de vénerie. Donner le change signifie qu'une bête parvient à ce que son prédateur (meute, chasseur...) se lance sur la trace d'un autre animal. Garder le change signifie au contraire que les chiens ne se laissent pas distraire par d'autres pistes et poursuivent la même proie.
 Chanson
de geste
Chanson
de geste- voir Geste.
 Chant
royal
Chant
royal
- nom masculin. Poème allégorique imaginé sous le règne de Charles V. Il se compose de cinq stances et un envoi, tous terminés par un refrain identique.
 Chape
Chape
- nom féminin, dus bas latin cappa (capuchon).
- 1.) Long manteau ecclésiastique sans manche, agrafé par devant, porté à l'occasion de certaines cérémonies.
- 2.) En héraldique, pièce honorable qui divise l'écu par deux diagonales partant du milieu du chef et rejoignant les angles de la pointe. La chape comprend les deux angles supérieurs de l'écu (voir VI Héraldique)
 Chapel
de fer
Chapel
de fer
- nom masculin, du latin capellus (chapeau). Connu bien avant l'ère chrétienne, casque en forme de dôme avec un large rebord. Fabriqué à partir d'un minimum de trois pièces, il se généralise en France et en Angleterre dès le XIIIe siècle auprès des fantassins et des archers/arbalétriers car sa forme protège bien la tête et une partie des épaules des projectiles et coups venant du haut. Ne gênant pas la visibilité ni la respiration comme un heaume, il est aussi apprécié par les chevaliers qui ne peuvent financer un bassinet, même s'il est alors souvent renforcé d'une protection pour le bas du visage. Il est remplacé à la Renaissance par le morion espagnol. On retrouve sa forme caractéristique jusque dans les casques de la première guerre mondiale, le Adrian en France et le Brodie au Royaume-Uni.
 Chapelain
Chapelain
- nom masculin, de chapelle. Religieux attaché à une chapelle ou une chapellenie. Il n'a pas de compétence sur un territoire précis mais plutôt une paroisse personnelle. Il peut être attaché au service particulier d'un noble ou d'un souverain. Il n'est responsable que de la communauté qu'il regroupe autour de lui et ne tient pas de registre.
 Chapelet
Chapelet
- nom masculin, de chapel (couronne de fleurs). Objet de dévotion en forme de collier, composé de grains enfilés sur un cordon que l'on fait défiler entre ses doigts en récitant des prières. Dans la religion catholique, chaque grain correspond à un Ave Maria. Chaque dixième grain, plus gros, correspond à un Pater. Le chapelet existe dans plusieurs autres religions pour la récitation de prières répétitives. Les matériaux utilisés sont très divers et on en trouve en bois, os, ivoire, métal, corail, émaux, perle...
 Chapelle
Chapelle
- nom féminin, du latin populaire capella (chape). Le nom proviendrait de la chape (casque ou cape ?) de St Martin, relique militaire devant laquelle les rois de France venaient prier avant les batailles. Ce lieu de culte est par essence itinérant.
- 1.) Lieu de culte en dehors d'une église, d'une cathédrale, qui ne bénéficie pas des droits paroissiaux habituels. Il peut être aussi bien en plein air que rattaché à la maison d'un seigneur ou d'un souverain.
- 2.) Subdivision d'une cathédrale ou d'une basilique, dans laquelle on trouve un autel secondaire destiné à la célébration de cérémonies. Dans la religion catholique, la chapelle est généralement consacrée à la vierge Marie si l'église est dédiée à un autre saint.
- 3.) Ensemble des objets de culte dont on se sert dans une chapelle : calice, bassin, burettes, chandeliers, croix.
- 4.) Ensemble des musiciens et instrumentistes dans l'église. Par extension, le lieu d'où est jouée la musique. Par extension encore, les musiciens du seigneur ou du roi, même s'ils ne jouent pas de musique religieuse.
- 5.) Terme d'alchimie. Alambic cylindrique bas à chapiteau conique très élevé, utilisé généralement pour la distillation des roses et aussi appelé rosaire. On l'utilise en chauffage lent et modéré.
 Chapellenie
Chapellenie
- nom féminin, du latin populaire capella (chape). Dignité, charge ou bénéfice du chapelain.
 Chaperon
Chaperon
- nom masculin, de chape (capuchon)
- 1.) Coiffure en forme de capuche, utilisée sous forme de chapeau à boudin. Sous le règne de Charles VI, les Bourguignons et les Armagnacs se distinguaient par la couleur de leur coiffe.
- 2.) Coiffe en cuir dont recouvre la tête des oiseaux de proie.
- 3.) Recouvrement d'une arête de muraille par un pan en forme de toit pour favoriser l'écoulement.
 Charge
Charge
- nom féminin.
- 1.) Fonction de représentation d'une autorité supérieure et les responsabilités qui en découlent. Exemple : une charge de bailli.
- 2.) Manoeuvre militaire qui consiste à lancer une troupe à pleine vitesse pour briser les lignes ennemies, les désorganiser et isoler les défenseurs par petits groupes, plus faciles à éliminer par les unités qui exploitent la percée. On utilise de préférence une troupe rapide et/ou puissante qui ne sera pas bloquée avant le choc. Au Moyen Age, on considère qu'aucune unité ne peut arrêter une charge de cavalerie lourde lancée au grand galop en terrain découvert.
 Charron
Charron
I. ACCUEIL II. ARMEMENT
III. CIVILISATION IV.
GLOSSAIRES V. HABITATIONS
VI. HERALDIQUE VII.
HISTOIRE
VIII. HOMMES IX. INSOLITE
X. SOURCES &
LIENS XI. QUESTIONS & IDEES
XII. COUP DE MAIN XIII. LIVRE
D'OR


