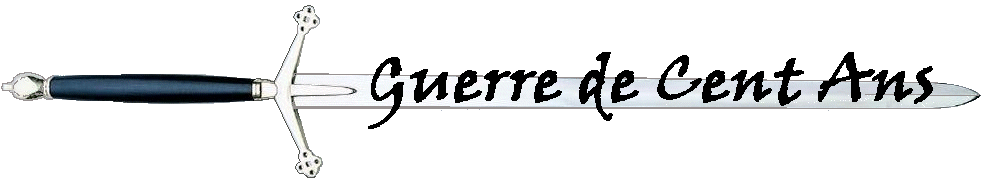
I. ACCUEIL II. ARMEMENT
III. CIVILISATION
IV.
GLOSSAIRES V. HABITATIONS
VI. HERALDIQUE VII.
HISTOIRE
VIII. HOMMES IX. INSOLITE
X. SOURCES &
LIENS XI. QUESTIONS & IDEES
XII. COUP DE MAIN XIII. LIVRE D'OR
![]()
 'expression
"Guerre de Cent Ans" est une création des historiens du XIXe
siècle pour désigner le conflit qui opposa de 1338 à 1453 les deux plus
puissants royaumes d'Occident chrétien, la France des Valois et l'Angleterre
des Plantagenêts, puis des Lancastre. Ce conflit interminable est en réalité
une succession de campagnes militaires coupées de longues trêves, dont les
caractères et les objectifs varient dans le temps. On peut classer les
multiples causes de ce conflit autour de cinq motifs principaux.
'expression
"Guerre de Cent Ans" est une création des historiens du XIXe
siècle pour désigner le conflit qui opposa de 1338 à 1453 les deux plus
puissants royaumes d'Occident chrétien, la France des Valois et l'Angleterre
des Plantagenêts, puis des Lancastre. Ce conflit interminable est en réalité
une succession de campagnes militaires coupées de longues trêves, dont les
caractères et les objectifs varient dans le temps. On peut classer les
multiples causes de ce conflit autour de cinq motifs principaux.
1.) Les conséquences des rivalités franco-angevines (à partir de 1159):
-
Antagonisme de la maison d'Anjou, les Plantagenêts, et de la maison de France, les Capétiens. D'autres maisons féodales se joignent à la lutte, notamment Bretagne, Champagne, Flandres et Toulouse.
-
Les Capétiens sont rois de France et cherchent à unifier le royaume, tandis que les Plantagenêts sont rois d'Angleterre et souhaitent briser le pouvoir royal.
-
Le roi d'Angleterre doit l'hommage lige au roi de France pour le duché de Guyenne mais Édouard III y répugne. De plus, le roi de France étant le suzerain des Anglais, toute attaque anglaise contre la France est une "félonie".
-
Le roi de France fait saisir les terres de son vassal pour le règlement de dettes (par exemple Puymirol en 1336),
-
Les seigneurs de Guyenne poussent leur suzerain à s'affranchir de la tutelle royale française.
2.) La question des Flandres :
- Louis de Nevers, le comte de Flandres, est l'allié du roi de France, mais les Flamands sont économiquement tributaires de la laine anglaise et soutiennent l'Angleterre.
3.) La querelle dynastique :
- Conséquence du traité de Montreuil-sur-Mer, Edouard III est le fils d'Isabelle de France et donc le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Selon le droit anglais, il est l'héritier de la couronne de France,
- Edouard III ne rejette pas le principe de la loi salique et admet qu'une femme ne puisse pas régner en France. Par contre, il prétend qu'une fille de roi peut transmettre à ses fils les droits à la couronne.
4.) Le soutien des grands barons à Philippe de Valois :
- Ils ne veulent pas d'un roi étranger,
- Ils préfèrent un roi moins puissant que le riche duc de Guyenne, soutenu par le royaume anglais.
5.) L'intervention de Robert III d'Artois :
- Il est le beau-frère du roi Philippe VI. Par un jugement de 1315, sa tante paternelle Mahaut d'Artois l'a dépossédé de son comté obtenu en apanage (son arrière-grand-père Robert Ier le Vaillant est le frère de Saint Louis). En 1329, il réclame son héritage à l'aide de documents falsifiés et empoisonne Mahaut ainsi que sa fille Jeanne. Menacé d'arrestation, il s'enfuit en Angleterre et pousse Edouard III à revendiquer la couronne de France.
![]()
 a
cause première de cette guerre ruineuse et dramatique est donc une querelle de
type féodal qui oppose les rois de France et d'Angleterre à propos de la
Guyenne. Depuis le mariage d'Henri II Plantagenêt avec Aliénor d'Aquitaine,
les rois d'Angleterre sont devenus en même temps ducs de Guyenne. Les
possessions anglaises sur le continent ont même été longtemps bien plus
vastes, mais le premier des grands rois capétiens, Philippe Auguste, en a
reconquis la plus grande partie. Cependant, les Anglais n'ont pas renoncé aux
provinces perdues et les Français espèrent les chasser un jour totalement du
royaume. Pour tenter d'établir une paix durable, Saint Louis négocie en 1259
le traité de Paris par lequel il cède quelques territoires à l'Angleterre et
lui abandonne la jouissance de l'Aquitaine. Mais en contrepartie, cette
principauté redevient un fief dont le possesseur doit prêter hommage au roi de
France. Ce traité, qui met un terme provisoire à plus d'un siècle de luttes
(la première guerre de Cent Ans) est pendant quatre-vingts ans l'instrument
diplomatique de base auquel on se réfère lorsque des conflits opposent le
nouveau vassal à son suzerain français. Mais les rois d'Angleterre finissent
par vouloir transformer leur fief continental en un alleu, détenu en toute indépendance.
L'alleu leur permettrait d'échapper aux pressions du roi de France qui prétend
au contraire ramener à des litiges d'ordre féodal tous les différends qui
l'opposent à l'Angleterre et multiplie ses interventions, n'hésitant pas à
prononcer la confiscation du fief pour la moindre offense. C'est ce que font
Philippe le Bel en 1294 et Charles IV en 1323. En 1327, un accord est conclu
selon lequel le roi de France devra renoncer à toute annexion. L'année
suivante, à la mort de Charles IV, le nouveau roi de France, Philippe de
Valois, obtient avec quelque difficulté l'hommage d'Edouard III d'Angleterre
pour la Guyenne. Mais, en dépit de ses engagements, la monarchie française
conserve l'Agenais et le Bazadais, réduisant l'Aquitaine à une mince bande de
terre, certes riche, le long de l'Atlantique. Ces derniers empiétements
ravivent le conflit, toujours latent. Les négociations ne peuvent aboutir. En
1336, l'impasse est totale.
a
cause première de cette guerre ruineuse et dramatique est donc une querelle de
type féodal qui oppose les rois de France et d'Angleterre à propos de la
Guyenne. Depuis le mariage d'Henri II Plantagenêt avec Aliénor d'Aquitaine,
les rois d'Angleterre sont devenus en même temps ducs de Guyenne. Les
possessions anglaises sur le continent ont même été longtemps bien plus
vastes, mais le premier des grands rois capétiens, Philippe Auguste, en a
reconquis la plus grande partie. Cependant, les Anglais n'ont pas renoncé aux
provinces perdues et les Français espèrent les chasser un jour totalement du
royaume. Pour tenter d'établir une paix durable, Saint Louis négocie en 1259
le traité de Paris par lequel il cède quelques territoires à l'Angleterre et
lui abandonne la jouissance de l'Aquitaine. Mais en contrepartie, cette
principauté redevient un fief dont le possesseur doit prêter hommage au roi de
France. Ce traité, qui met un terme provisoire à plus d'un siècle de luttes
(la première guerre de Cent Ans) est pendant quatre-vingts ans l'instrument
diplomatique de base auquel on se réfère lorsque des conflits opposent le
nouveau vassal à son suzerain français. Mais les rois d'Angleterre finissent
par vouloir transformer leur fief continental en un alleu, détenu en toute indépendance.
L'alleu leur permettrait d'échapper aux pressions du roi de France qui prétend
au contraire ramener à des litiges d'ordre féodal tous les différends qui
l'opposent à l'Angleterre et multiplie ses interventions, n'hésitant pas à
prononcer la confiscation du fief pour la moindre offense. C'est ce que font
Philippe le Bel en 1294 et Charles IV en 1323. En 1327, un accord est conclu
selon lequel le roi de France devra renoncer à toute annexion. L'année
suivante, à la mort de Charles IV, le nouveau roi de France, Philippe de
Valois, obtient avec quelque difficulté l'hommage d'Edouard III d'Angleterre
pour la Guyenne. Mais, en dépit de ses engagements, la monarchie française
conserve l'Agenais et le Bazadais, réduisant l'Aquitaine à une mince bande de
terre, certes riche, le long de l'Atlantique. Ces derniers empiétements
ravivent le conflit, toujours latent. Les négociations ne peuvent aboutir. En
1336, l'impasse est totale.
![]()
 la querelle de Guyenne vient se greffer un problème dynastique. Alors que de la
fin du Xe siècle au début du XIVe siècle, les rois ont
pu se succéder en France de père en fils, inscrivant la règle de l'hérédité
masculine dans les faits, sinon dans le droit, trois rois disparaissent au début
du XIVe siècle sans laisser d'héritier mâle. A la mort de Louis X
le Hutin en 1316, suivie peu de temps après de celle de son fils posthume Jean
Ier (1316), la couronne aurait pu revenir à la fille du roi défunt, Jeanne d'Évreux.
Pourtant, c'est le plus âgé des frères du roi qui s'empare du pouvoir sous le
nom de Philippe V. Le précédent est créé et, pour asseoir sa légitimité,
le nouveau souverain fait adopter par une assemblée de notables le principe
d'après lequel "femme ne règne en France", reprenant à son compte
la très ancienne "loi salique" des Francs Saliens, l'un des piliers
de la royauté en France. De même, lorsque Philippe V meurt en 1322 en ne
laissant que des filles, aussitôt son dernier frère Charles IV se fait reconnaître
comme roi. Il disparaît à son tour en 1328 sans héritier mâle. Parmi les
trois candidats possibles à la couronne figure Edouard III, roi d'Angleterre
depuis quelques mois, petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle
d'Aragon. Sa candidature n'est valable que dans la mesure où il est admis qu'à
défaut de porter la couronne, une femme peut la transmettre.
la querelle de Guyenne vient se greffer un problème dynastique. Alors que de la
fin du Xe siècle au début du XIVe siècle, les rois ont
pu se succéder en France de père en fils, inscrivant la règle de l'hérédité
masculine dans les faits, sinon dans le droit, trois rois disparaissent au début
du XIVe siècle sans laisser d'héritier mâle. A la mort de Louis X
le Hutin en 1316, suivie peu de temps après de celle de son fils posthume Jean
Ier (1316), la couronne aurait pu revenir à la fille du roi défunt, Jeanne d'Évreux.
Pourtant, c'est le plus âgé des frères du roi qui s'empare du pouvoir sous le
nom de Philippe V. Le précédent est créé et, pour asseoir sa légitimité,
le nouveau souverain fait adopter par une assemblée de notables le principe
d'après lequel "femme ne règne en France", reprenant à son compte
la très ancienne "loi salique" des Francs Saliens, l'un des piliers
de la royauté en France. De même, lorsque Philippe V meurt en 1322 en ne
laissant que des filles, aussitôt son dernier frère Charles IV se fait reconnaître
comme roi. Il disparaît à son tour en 1328 sans héritier mâle. Parmi les
trois candidats possibles à la couronne figure Edouard III, roi d'Angleterre
depuis quelques mois, petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle
d'Aragon. Sa candidature n'est valable que dans la mesure où il est admis qu'à
défaut de porter la couronne, une femme peut la transmettre.
![]()
 cette question restée jusque-là sans réponse, les barons français répondent
par la négative en préférant au souverain anglais le petit-fils de Philippe
III par la branche mâle, Philippe VI de Valois. Comme le dit une chronique
anglaise de l'époque, le fait que le nouveau roi est "né du royaume"
ne sera pas étranger à leur choix. Avant même le sacre en 1328, Edouard III
envoie une ambassade en France, chargée d'exposer ses droits à la couronne,
revendication d'abord assez platonique, puisqu'il accepte de prêter hommage
pour la Guyenne en 1329. Mais la réouverture du conflit aquitain et le soutien
apporté par les Valois à ses adversaires écossais amènent Edouard III à
faire de ses prétentions au trône de France un moyen de justifier sa cause.
L'attitude de celui qu'il persiste à tenir pour un vassal révolté détermine
Philippe VI à prononcer une nouvelle fois la confiscation de la Guyenne.
Edouard III répond en faisant désigner son adversaire, dans les actes de sa
chancellerie, sous le nom de "Philippe, qui se dit roi de France",
puis en revendiquant publiquement le royaume de France et en reniant l'hommage
qu'il a prêté pour l'Aquitaine, enfin en faisant porter son défi à Paris en
1337. La rupture est officielle, la guerre ouverte commence.
cette question restée jusque-là sans réponse, les barons français répondent
par la négative en préférant au souverain anglais le petit-fils de Philippe
III par la branche mâle, Philippe VI de Valois. Comme le dit une chronique
anglaise de l'époque, le fait que le nouveau roi est "né du royaume"
ne sera pas étranger à leur choix. Avant même le sacre en 1328, Edouard III
envoie une ambassade en France, chargée d'exposer ses droits à la couronne,
revendication d'abord assez platonique, puisqu'il accepte de prêter hommage
pour la Guyenne en 1329. Mais la réouverture du conflit aquitain et le soutien
apporté par les Valois à ses adversaires écossais amènent Edouard III à
faire de ses prétentions au trône de France un moyen de justifier sa cause.
L'attitude de celui qu'il persiste à tenir pour un vassal révolté détermine
Philippe VI à prononcer une nouvelle fois la confiscation de la Guyenne.
Edouard III répond en faisant désigner son adversaire, dans les actes de sa
chancellerie, sous le nom de "Philippe, qui se dit roi de France",
puis en revendiquant publiquement le royaume de France et en reniant l'hommage
qu'il a prêté pour l'Aquitaine, enfin en faisant porter son défi à Paris en
1337. La rupture est officielle, la guerre ouverte commence.
Les succès anglais et le traité de Brétigny (1338-1360).
![]()
 orsque
s'ouvre le conflit, la France, plus peuplée et plus riche (15 millions
d'habitants contre 4 pour l'Angleterre), semble devoir triompher facilement.
Mais si l'Angleterre, par son économie de caractère semi-colonial comme par
son développement culturel, connaît un certain retard, en revanche ses
structures administratives et gouvernementales se rangent parmi les plus évoluées.
Ces atouts se révèlent décisifs dans une première phase du conflit face à
aux Français qui traversent une grave crise économique et financière.
orsque
s'ouvre le conflit, la France, plus peuplée et plus riche (15 millions
d'habitants contre 4 pour l'Angleterre), semble devoir triompher facilement.
Mais si l'Angleterre, par son économie de caractère semi-colonial comme par
son développement culturel, connaît un certain retard, en revanche ses
structures administratives et gouvernementales se rangent parmi les plus évoluées.
Ces atouts se révèlent décisifs dans une première phase du conflit face à
aux Français qui traversent une grave crise économique et financière.
![]()
 es
premières chevauchées anglaises dans le nord de la France n'apportent aucun résultat,
mais des succès diplomatiques importants viennent les compenser. Edouard III
joue habilement la carte des intérêts économiques qui lient la Flandre à
l'Angleterre pour détacher les Pays-Bas de l'orbite française : en interdisant
l'exportation des laines anglaises indispensables à l'industrie drapière
flamande, il provoque et encourage la révolte des riches cités flamandes,
derrière Jacques van Artevelde, contre leur comte, Louis de Nevers, demeuré
fidèle à Philippe VI. Il signe avec elles un traité par lequel elles
s'engagent à l'aider militairement et à l'accepter comme véritable roi de
France (1339). Il soutient également Robert d'Artois révolté contre Philippe
VI, gagne à sa cause le Hainaut et le Brabant en transférant une partie des
intérêts anglais dans ces régions. Il contracte aussi de nombreuses alliances
en Allemagne, avec pour résultat à l'été 1337, l'alliance avec l'empereur
Louis IV de Bavière qui dès 1338, l'institue son vicaire impérial pour la
rive gauche du Rhin.
es
premières chevauchées anglaises dans le nord de la France n'apportent aucun résultat,
mais des succès diplomatiques importants viennent les compenser. Edouard III
joue habilement la carte des intérêts économiques qui lient la Flandre à
l'Angleterre pour détacher les Pays-Bas de l'orbite française : en interdisant
l'exportation des laines anglaises indispensables à l'industrie drapière
flamande, il provoque et encourage la révolte des riches cités flamandes,
derrière Jacques van Artevelde, contre leur comte, Louis de Nevers, demeuré
fidèle à Philippe VI. Il signe avec elles un traité par lequel elles
s'engagent à l'aider militairement et à l'accepter comme véritable roi de
France (1339). Il soutient également Robert d'Artois révolté contre Philippe
VI, gagne à sa cause le Hainaut et le Brabant en transférant une partie des
intérêts anglais dans ces régions. Il contracte aussi de nombreuses alliances
en Allemagne, avec pour résultat à l'été 1337, l'alliance avec l'empereur
Louis IV de Bavière qui dès 1338, l'institue son vicaire impérial pour la
rive gauche du Rhin.
![]()
 ar
cette coalition, la monarchie française se trouve menacée de deux côtés à
la fois. Fort de ces succès, Edouard III prend solennellement à Gand, en
janvier 1340, le titre de roi de France, introduisant les fleurs de lys dans son
Grand Sceau et dans ses armes. Cinq mois plus tard, le 24 juin 1340, la flotte
française est totalement défaite à l'Ecluse, près de l'avant-port de Bruges,
désastre qui fait perdre à la France le contrôle de la mer. Le conflit
rebondit avec les débuts de la guerre de succession de Bretagne qui oppose deux
candidats, Jean de Montfort, soutenu par Edouard III, et Charles de Blois
qu'appuie Philippe VI. Une trêve l'interrompt en janvier 1343. Edouard III peut
alors reprendre ses autres desseins. Une nouvelle armée anglaise, débarquée
en Normandie, se livre à la première des grandes chevauchées anglaises. Après
avoir parcouru plus de 350 kilomètres en un mois, elle rencontre l'armée française
à Crécy le 26 août 1346. Les Français y essuient une cuisante défaite.
ar
cette coalition, la monarchie française se trouve menacée de deux côtés à
la fois. Fort de ces succès, Edouard III prend solennellement à Gand, en
janvier 1340, le titre de roi de France, introduisant les fleurs de lys dans son
Grand Sceau et dans ses armes. Cinq mois plus tard, le 24 juin 1340, la flotte
française est totalement défaite à l'Ecluse, près de l'avant-port de Bruges,
désastre qui fait perdre à la France le contrôle de la mer. Le conflit
rebondit avec les débuts de la guerre de succession de Bretagne qui oppose deux
candidats, Jean de Montfort, soutenu par Edouard III, et Charles de Blois
qu'appuie Philippe VI. Une trêve l'interrompt en janvier 1343. Edouard III peut
alors reprendre ses autres desseins. Une nouvelle armée anglaise, débarquée
en Normandie, se livre à la première des grandes chevauchées anglaises. Après
avoir parcouru plus de 350 kilomètres en un mois, elle rencontre l'armée française
à Crécy le 26 août 1346. Les Français y essuient une cuisante défaite.
![]()
 eprenant
sa route, Edouard III arrive sous les murs de Calais. Au terme d'un siège de
onze mois (septembre 1346-août 1347), la ville doit se rendre (épisode des
Bourgeois de Calais). Devenue anglaise, elle succédera à Bruges comme place
principale des marchands anglais. A la suite de ces échecs successifs, la
position et l'autorité de Philippe VI se sont inévitablement détériorées et
la monarchie française traverse une grave crise intérieure, marquée par une véritable
révolution de palais autour du roi. Toutefois, ni Crécy ni Calais n'ont définitivement
réglé le différend franco-anglais. Une trêve est conclue le 28 septembre
1347. Elle se trouve prolongée jusqu'en juin 1355 par un événement extérieur
au conflit : la peste noire qui, venue d'Asie, se répand en France et en
Angleterre en 1347.
eprenant
sa route, Edouard III arrive sous les murs de Calais. Au terme d'un siège de
onze mois (septembre 1346-août 1347), la ville doit se rendre (épisode des
Bourgeois de Calais). Devenue anglaise, elle succédera à Bruges comme place
principale des marchands anglais. A la suite de ces échecs successifs, la
position et l'autorité de Philippe VI se sont inévitablement détériorées et
la monarchie française traverse une grave crise intérieure, marquée par une véritable
révolution de palais autour du roi. Toutefois, ni Crécy ni Calais n'ont définitivement
réglé le différend franco-anglais. Une trêve est conclue le 28 septembre
1347. Elle se trouve prolongée jusqu'en juin 1355 par un événement extérieur
au conflit : la peste noire qui, venue d'Asie, se répand en France et en
Angleterre en 1347.
![]()
 orsque
Philippe VI meurt en 1350, le bilan de son règne est loin d'être positif. Seul
élément favorable, le nouveau comte de Flandre, Louis de Mâle, fait
prisonnier à Crécy, a pu s'échapper et obtenir en 1349 la soumission des
villes flamandes. Retournement de situation qui se traduit pour Edouard III par
la perte d'un appui continental précieux. Il ne le retrouvera jamais. Edouard
se procure par contre un autre allié de taille dans la personne de Charles le
Mauvais, le propre gendre du nouveau roi de France Jean II le Bon. Charles le
Mauvais, roi de Navarre, ulcéré de n'obtenir aucune compensation territoriale
pour prix de son abandon du comté d'Angoulême en faveur de la couronne, se révolte
ouvertement contre le roi. Il accepte de se soumettre après avoir reçu le comté
de Beaumont-le-Roger et la plus grande partie du Cotentin, mais cette réconciliation
est sans lendemain. Elle sera suivie de vingt-cinq années de complots et
d'intrigues. A la même date, l'échec de nouvelles négociations
franco-anglaises accule Jean II le Bon à la guerre.
orsque
Philippe VI meurt en 1350, le bilan de son règne est loin d'être positif. Seul
élément favorable, le nouveau comte de Flandre, Louis de Mâle, fait
prisonnier à Crécy, a pu s'échapper et obtenir en 1349 la soumission des
villes flamandes. Retournement de situation qui se traduit pour Edouard III par
la perte d'un appui continental précieux. Il ne le retrouvera jamais. Edouard
se procure par contre un autre allié de taille dans la personne de Charles le
Mauvais, le propre gendre du nouveau roi de France Jean II le Bon. Charles le
Mauvais, roi de Navarre, ulcéré de n'obtenir aucune compensation territoriale
pour prix de son abandon du comté d'Angoulême en faveur de la couronne, se révolte
ouvertement contre le roi. Il accepte de se soumettre après avoir reçu le comté
de Beaumont-le-Roger et la plus grande partie du Cotentin, mais cette réconciliation
est sans lendemain. Elle sera suivie de vingt-cinq années de complots et
d'intrigues. A la même date, l'échec de nouvelles négociations
franco-anglaises accule Jean II le Bon à la guerre.
![]()
 a
campagne de 1355-1356 est menée par le fils aîné Edouard III, le prince
Edouard de Galles dit le Prince Noir. Il mène en 1355 une fructueuse chevauchée
à travers le Languedoc et inflige à Jean II le Bon la lourde défaite de
Poitiers (19 septembre 1356). Le roi de France se trouve parmi les prisonniers.
La nouvelle du désastre est suivie d'une flambée de révolte à tous les
niveaux de la société contre l'autorité royale. Le dauphin Charles (futur
Charles V le Sage), alors âgé de 18 ans, doit faire face à une opposition
organisée, dirigée par Robert Le Coq, évêque de Laon, devenu le séide du
roi de Navarre, et surtout Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Le
dessein de ce dernier est d'entreprendre, selon le mot du temps, la réformation
de l'Etat, d'écarter son personnel le plus corrompu et d'établir sur la
monarchie un contrôle exercé par des représentants des trois ordres au moyen
d'un Conseil qui aurait "puissance de tout faire et ordonner au royaume
aussi comme le roi". Le dauphin doit s'incliner et ratifier la Grande
Ordonnance de mars 1357. Mais tandis que les états généraux expriment surtout
les vues de la bourgeoisie parisienne et formulent des exigences toujours plus
grandes, les états provinciaux plus modérés cherchent à contrôler la
perception et l'utilisation des impôts, sans trop se soucier de la grande
politique qu'ils abandonnent volontiers au pouvoir royal. Bientôt la situation
tourne au désavantage d'Etienne Marcel qui ne peut plus compter que sur la
capitale. Un nouveau danger apparaît avec le soulèvement paysan des Jacques,
insurrection de la misère dirigée contre les castes de privilégiés. Le
mouvement est rapidement et impitoyablement écrasé. Etienne Marcel, lui, perd
toute sa popularité lorsque sa collusion avec les Anglais devient évidente. Il
est assassiné en 1358 et le dauphin peut faire son entrée dans Paris. La révolution
parisienne a échoué. C'est le triomphe de la monarchie. Une fois l'ordre rétabli,
les négociations peuvent commencer avec les Anglais, d'autant plus que le roi
de Navarre a lui aussi abandonné la partie. Elles aboutissent au dur traité de
Brétigny, signé le 1er mai 1360. Edouard III reçoit en toute
souveraineté une grande Aquitaine, allant de la Loire au Massif central et aux
Pyrénées, Calais et ses marches, le Ponthieu et le comté de Guines : le tiers
du royaume environ. La rançon de Jean II le Bon est fixée à 3 millions d'écus.
En revanche, Edouard III renonce à la couronne de France et s'engage à
abandonner les forteresses occupées par ses troupes dans la partie du royaume
restant aux Valois. On peut penser à une pacification durable de l'Occident.
a
campagne de 1355-1356 est menée par le fils aîné Edouard III, le prince
Edouard de Galles dit le Prince Noir. Il mène en 1355 une fructueuse chevauchée
à travers le Languedoc et inflige à Jean II le Bon la lourde défaite de
Poitiers (19 septembre 1356). Le roi de France se trouve parmi les prisonniers.
La nouvelle du désastre est suivie d'une flambée de révolte à tous les
niveaux de la société contre l'autorité royale. Le dauphin Charles (futur
Charles V le Sage), alors âgé de 18 ans, doit faire face à une opposition
organisée, dirigée par Robert Le Coq, évêque de Laon, devenu le séide du
roi de Navarre, et surtout Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Le
dessein de ce dernier est d'entreprendre, selon le mot du temps, la réformation
de l'Etat, d'écarter son personnel le plus corrompu et d'établir sur la
monarchie un contrôle exercé par des représentants des trois ordres au moyen
d'un Conseil qui aurait "puissance de tout faire et ordonner au royaume
aussi comme le roi". Le dauphin doit s'incliner et ratifier la Grande
Ordonnance de mars 1357. Mais tandis que les états généraux expriment surtout
les vues de la bourgeoisie parisienne et formulent des exigences toujours plus
grandes, les états provinciaux plus modérés cherchent à contrôler la
perception et l'utilisation des impôts, sans trop se soucier de la grande
politique qu'ils abandonnent volontiers au pouvoir royal. Bientôt la situation
tourne au désavantage d'Etienne Marcel qui ne peut plus compter que sur la
capitale. Un nouveau danger apparaît avec le soulèvement paysan des Jacques,
insurrection de la misère dirigée contre les castes de privilégiés. Le
mouvement est rapidement et impitoyablement écrasé. Etienne Marcel, lui, perd
toute sa popularité lorsque sa collusion avec les Anglais devient évidente. Il
est assassiné en 1358 et le dauphin peut faire son entrée dans Paris. La révolution
parisienne a échoué. C'est le triomphe de la monarchie. Une fois l'ordre rétabli,
les négociations peuvent commencer avec les Anglais, d'autant plus que le roi
de Navarre a lui aussi abandonné la partie. Elles aboutissent au dur traité de
Brétigny, signé le 1er mai 1360. Edouard III reçoit en toute
souveraineté une grande Aquitaine, allant de la Loire au Massif central et aux
Pyrénées, Calais et ses marches, le Ponthieu et le comté de Guines : le tiers
du royaume environ. La rançon de Jean II le Bon est fixée à 3 millions d'écus.
En revanche, Edouard III renonce à la couronne de France et s'engage à
abandonner les forteresses occupées par ses troupes dans la partie du royaume
restant aux Valois. On peut penser à une pacification durable de l'Occident.
La reprise de la guerre et le redressement français (1360-1388).
![]()
 n
réalité, la paix n'est pas durable. Les retards apportés dans le transfert
des territoires au profit de l'Angleterre apportent à Edouard III l'occasion de
reprendre ses prétentions dynastiques, tandis que Jean le Bon ne ratifie pas
ses renonciations et conserve donc implicitement ses droits sur les provinces
perdues. Sur le continent, une nouvelle source de conflit surgit en novembre
1361, lorsque Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, meurt sans laisser d'héritier
direct. Deux candidats peuvent revendiquer le duché : Jean II le Bon et son
gendre Charles le Mauvais, respectivement fils et petit-fils de la grand-tante
du duc défunt. Jean le Bon, qui se trouve juge et partie, tranche en sa propre
faveur et fait de la Bourgogne en 1363 un apanage pour Philippe le Hardi, son
fils préféré, jetant ainsi sans le savoir les bases de l'état bourguignon
qui menacera de submerger ses successeurs. De plus, le versement de la rançon
de Jean le Bon ne s'effectue pas dans les délais prévus. Il est vrai
qu'Edouard III détient en garantie six princes des fleurs de lys : frère, fils
ou parent du roi. Mais le duc Louis d'Anjou fausse compagnie à ses gardiens en
septembre 1363 et Jean le Bon se croit moralement obligé de se constituer de
nouveau prisonnier. Il meurt durant cette seconde captivité, le 8 avril 1364.
Le dauphin Charles devient le roi Charles V le Sage. Charles le Mauvais rejette
l'arbitrage du roi sur la succession de la Bourgogne, mais il est battu à
Cocherel par Bertrand du Guesclin en 1364. Un traité conclu en mars 1365 lui
accorde la co-seigneurie de Montpellier mais lui enlève toutes ses places de la
basse Seine en aval de Paris.
n
réalité, la paix n'est pas durable. Les retards apportés dans le transfert
des territoires au profit de l'Angleterre apportent à Edouard III l'occasion de
reprendre ses prétentions dynastiques, tandis que Jean le Bon ne ratifie pas
ses renonciations et conserve donc implicitement ses droits sur les provinces
perdues. Sur le continent, une nouvelle source de conflit surgit en novembre
1361, lorsque Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, meurt sans laisser d'héritier
direct. Deux candidats peuvent revendiquer le duché : Jean II le Bon et son
gendre Charles le Mauvais, respectivement fils et petit-fils de la grand-tante
du duc défunt. Jean le Bon, qui se trouve juge et partie, tranche en sa propre
faveur et fait de la Bourgogne en 1363 un apanage pour Philippe le Hardi, son
fils préféré, jetant ainsi sans le savoir les bases de l'état bourguignon
qui menacera de submerger ses successeurs. De plus, le versement de la rançon
de Jean le Bon ne s'effectue pas dans les délais prévus. Il est vrai
qu'Edouard III détient en garantie six princes des fleurs de lys : frère, fils
ou parent du roi. Mais le duc Louis d'Anjou fausse compagnie à ses gardiens en
septembre 1363 et Jean le Bon se croit moralement obligé de se constituer de
nouveau prisonnier. Il meurt durant cette seconde captivité, le 8 avril 1364.
Le dauphin Charles devient le roi Charles V le Sage. Charles le Mauvais rejette
l'arbitrage du roi sur la succession de la Bourgogne, mais il est battu à
Cocherel par Bertrand du Guesclin en 1364. Un traité conclu en mars 1365 lui
accorde la co-seigneurie de Montpellier mais lui enlève toutes ses places de la
basse Seine en aval de Paris.
![]()
 a
lutte se prolonge également en Bretagne entre les partisans de Jean de
Montfort, fils du premier Jean de Montfort, toujours soutenu par l'Angleterre,
et ceux de Charles de Blois, libéré en 1356 au terme d'une longue captivité.
En 1364, Charles de Blois est battu et tué à Auray par Jean de Montfort. Du
Guesclin, qui l'assiste, est fait prisonnier. Charles V est alors contraint de
traiter. Par la Paix de Guérande (avril 1365), il reconnaît Jean de Montfort
comme duc de Bretagne, mais en échange, ce dernier doit lui prêter hommage,
faisant ainsi rentrer son fief dans la mouvance du roi de France.
a
lutte se prolonge également en Bretagne entre les partisans de Jean de
Montfort, fils du premier Jean de Montfort, toujours soutenu par l'Angleterre,
et ceux de Charles de Blois, libéré en 1356 au terme d'une longue captivité.
En 1364, Charles de Blois est battu et tué à Auray par Jean de Montfort. Du
Guesclin, qui l'assiste, est fait prisonnier. Charles V est alors contraint de
traiter. Par la Paix de Guérande (avril 1365), il reconnaît Jean de Montfort
comme duc de Bretagne, mais en échange, ce dernier doit lui prêter hommage,
faisant ainsi rentrer son fief dans la mouvance du roi de France.
![]()
 e
roi de Navarre neutralisé, la querelle se de Bretagne réglée, reste le problème
des Compagnies, groupes armés qui, le plus souvent, ont été à la solde d'une
autorité légitime mais, une fois cassés, refusent de se disperser et
continuent la guerre pour leur propre compte. En 1360 et 1368, à plusieurs
reprises, les Compagnies se réunissent pour donner naissance à de véritables
armées, appelées Grandes Compagnies. L'Espagne leur fournit un exutoire en
1365-1366. Sous la conduite de Du Guesclin, bien fait pour les comprendre et les
commander, elles se mettent au service d'Henri de Trastamare, qui avec l'appui
de Charles V, prétend chasser du trône de Castille le peu populaire Pierre le
Cruel. Ce dernier est finalement vaincu et Henri de Trastamare tue son rival à
Montiel en mai 1369. Dans l'affaire, Charles V gagne l'appui durable de la
Castille et a débarrassé la France des Compagnies qui, dans les dernières années
du XIVe siècle, ne représentent plus qu'un fléau local.
e
roi de Navarre neutralisé, la querelle se de Bretagne réglée, reste le problème
des Compagnies, groupes armés qui, le plus souvent, ont été à la solde d'une
autorité légitime mais, une fois cassés, refusent de se disperser et
continuent la guerre pour leur propre compte. En 1360 et 1368, à plusieurs
reprises, les Compagnies se réunissent pour donner naissance à de véritables
armées, appelées Grandes Compagnies. L'Espagne leur fournit un exutoire en
1365-1366. Sous la conduite de Du Guesclin, bien fait pour les comprendre et les
commander, elles se mettent au service d'Henri de Trastamare, qui avec l'appui
de Charles V, prétend chasser du trône de Castille le peu populaire Pierre le
Cruel. Ce dernier est finalement vaincu et Henri de Trastamare tue son rival à
Montiel en mai 1369. Dans l'affaire, Charles V gagne l'appui durable de la
Castille et a débarrassé la France des Compagnies qui, dans les dernières années
du XIVe siècle, ne représentent plus qu'un fléau local.
![]()
 a
succession de Flandre peut constituer un danger sérieux pour Charles V. Alors
que son père, Louis de Nevers, avait toujours tenu pour les Valois, Louis II de
Mâle, son successeur, songe après 1360 à se rapprocher d'Edouard III. Il
pense même à donner son unique héritière, Marguerite de Flandre, veuve de
Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, en mariage à l'un des fils d'Edouard
III. Mais la diplomatie de Charles V réussit à écarter ce projet. Au
contraire, en 1369, c'est Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui épouse
Marguerite de Flandre. Si l'union de la Flandre et de la Bourgogne se révélera
plus tard dangereuse pour la France, nul ne peut le prévoir et, au moment où
elle se fait, elle offre un appui décisif pour le roi de France.
a
succession de Flandre peut constituer un danger sérieux pour Charles V. Alors
que son père, Louis de Nevers, avait toujours tenu pour les Valois, Louis II de
Mâle, son successeur, songe après 1360 à se rapprocher d'Edouard III. Il
pense même à donner son unique héritière, Marguerite de Flandre, veuve de
Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, en mariage à l'un des fils d'Edouard
III. Mais la diplomatie de Charles V réussit à écarter ce projet. Au
contraire, en 1369, c'est Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui épouse
Marguerite de Flandre. Si l'union de la Flandre et de la Bourgogne se révélera
plus tard dangereuse pour la France, nul ne peut le prévoir et, au moment où
elle se fait, elle offre un appui décisif pour le roi de France.
![]()
 'horizon
de la monarchie française s'est donc singulièrement dégagé et, de part et
d'autre, nul ne semble envisager sérieusement la reprise des hostilités. Les
circonstances en décident autrement. Edouard III regroupe toutes ses
possessions du sud-ouest en une vaste principauté d'Aquitaine qu'il confie à
son fils aîné, le Prince Noir. Ce dernier met en place une administration
efficace, rigoureuse, mais ses interventions en Castille désorganisent ses
finances et l'obligent à lever de nouveaux impôts. Les protestations se
multiplient. La plus violente vient du comte d'Armagnac qui demande l'arbitrage
de Charles V. Effectivement, jusqu'à l'échange des renonciations qui n'a
toujours pas eu lieu, le roi de France garde la souveraineté dans les
territoires cédés. Acceptant l'appel du comte d'Armagnac, Charles V cite à
comparaître le Prince Noir devant le parlement de Paris. Froissart a rapporté
la réponse du prince anglais, pleine de superbe : "Nous irons volontiers
à Paris au jour où nous sommes cités, puisqu'il est ainsi commandé par le
roi de France, mais ce sera le bassinet en tête avec 60 000 hommes de notre
compagnie". En riposte, Edouard III reprend le 3 juin 1368 le titre de roi
de France. Enfin, le 30 novembre, Charles V prononce une nouvelle fois la
confiscation de la Guyenne. A cette date, les hostilités ont repris depuis
plusieurs mois. Ainsi, à la différence de ses deux prédécesseurs qui avaient
une réputation batailleuse et chevaleresque mais qui n'avaient jamais pris
l'initiative de la guerre, Charles V le "sage roi" soucieux de bon
gouvernement, à qui sa santé interdit de faire campagne en personne, mène
lucidement entre 1368 et 1369 une politique qui ne peut déboucher que sur la
guerre, à une époque où ni le problème castillan ni le problème flamand ne
sont résolus.
'horizon
de la monarchie française s'est donc singulièrement dégagé et, de part et
d'autre, nul ne semble envisager sérieusement la reprise des hostilités. Les
circonstances en décident autrement. Edouard III regroupe toutes ses
possessions du sud-ouest en une vaste principauté d'Aquitaine qu'il confie à
son fils aîné, le Prince Noir. Ce dernier met en place une administration
efficace, rigoureuse, mais ses interventions en Castille désorganisent ses
finances et l'obligent à lever de nouveaux impôts. Les protestations se
multiplient. La plus violente vient du comte d'Armagnac qui demande l'arbitrage
de Charles V. Effectivement, jusqu'à l'échange des renonciations qui n'a
toujours pas eu lieu, le roi de France garde la souveraineté dans les
territoires cédés. Acceptant l'appel du comte d'Armagnac, Charles V cite à
comparaître le Prince Noir devant le parlement de Paris. Froissart a rapporté
la réponse du prince anglais, pleine de superbe : "Nous irons volontiers
à Paris au jour où nous sommes cités, puisqu'il est ainsi commandé par le
roi de France, mais ce sera le bassinet en tête avec 60 000 hommes de notre
compagnie". En riposte, Edouard III reprend le 3 juin 1368 le titre de roi
de France. Enfin, le 30 novembre, Charles V prononce une nouvelle fois la
confiscation de la Guyenne. A cette date, les hostilités ont repris depuis
plusieurs mois. Ainsi, à la différence de ses deux prédécesseurs qui avaient
une réputation batailleuse et chevaleresque mais qui n'avaient jamais pris
l'initiative de la guerre, Charles V le "sage roi" soucieux de bon
gouvernement, à qui sa santé interdit de faire campagne en personne, mène
lucidement entre 1368 et 1369 une politique qui ne peut déboucher que sur la
guerre, à une époque où ni le problème castillan ni le problème flamand ne
sont résolus.
![]()
 es
premières campagnes françaises sont couronnées de succès. A la fin de l'année
1377, les provinces perdues dix-sept ans plus tôt sont presque entièrement récupérées,
et Charles le Mauvais, dont les intrigues avec le roi d'Angleterre et le duc de
Bretagne ont été dévoilées, a vu ses forteresses investies une à une par le
duc Philippe de Bourgogne. Toutefois les Anglais tiennent toujours solidement
Calais, Bordeaux et Bayonne. Ils contrôlent encore un grand nombre de
forteresses dans le centre-ouest de la France et ont réussi à s'emparer de
Cherbourg. Enfin Charles V essuie un échec en Bretagne. Lorsque le duc Jean IV
s'était réfugié en Angleterre, il croit pouvoir annexer facilement le duché.
C'est méconnaître la force du particularisme breton. A son retour, en 1379,
Jean IV reçoit un accueil enthousiaste et Charles V doit lui restituer son duché
(second traité de Guérande, avril 1381).
es
premières campagnes françaises sont couronnées de succès. A la fin de l'année
1377, les provinces perdues dix-sept ans plus tôt sont presque entièrement récupérées,
et Charles le Mauvais, dont les intrigues avec le roi d'Angleterre et le duc de
Bretagne ont été dévoilées, a vu ses forteresses investies une à une par le
duc Philippe de Bourgogne. Toutefois les Anglais tiennent toujours solidement
Calais, Bordeaux et Bayonne. Ils contrôlent encore un grand nombre de
forteresses dans le centre-ouest de la France et ont réussi à s'emparer de
Cherbourg. Enfin Charles V essuie un échec en Bretagne. Lorsque le duc Jean IV
s'était réfugié en Angleterre, il croit pouvoir annexer facilement le duché.
C'est méconnaître la force du particularisme breton. A son retour, en 1379,
Jean IV reçoit un accueil enthousiaste et Charles V doit lui restituer son duché
(second traité de Guérande, avril 1381).
![]()
 e
décès à trois ans d'intervalle d'Edouard III puis de Charles V et l'avènement
de deux rois très jeunes, Richard II en Angleterre et Charles VI en France, créent
de nouvelles conditions dans le déroulement du conflit. En France, les oncles
du nouveau roi s'entendent pour exercer en commun le pouvoir pendant sa minorité.
Les conseillers du règne précédent, qui ont reçu le surnom de Marmousets en
raison de leur origine souvent modeste sont écartés. L'achèvement de l'œuvre
de réorganisation entreprise par Charles V est négligée. Chacun des oncles
poursuit sa politique personnelle, d'où des intrigues et des conflits
continuels. Jean de Berry veut faire fortune grâce à sa lieutenance du
Languedoc, Philippe de Bourgogne songe à la Flandre et Louis d'Anjou au royaume
de Naples. Les nouveaux impôts levés pour aider ce dernier dans ses
entreprises entraînent des troubles populaires, notamment à Rouen (la Harelle)
et à Paris (révolte des Maillotins). L'anarchie atteint également Gand qui,
sous l'impulsion de Philippe van Artevelde, fils du grand homme politique des
années 1340, réclame l'alliance économique et militaire avec l'Angleterre.
Pour le gouvernement des oncles, la révolte flamande est très dangereuse. Ils
réunissent une forte armée qui écrase les milices gantoises à Roosebeke.
(1382). Mais sollicités par leurs intérêts personnels, ils se désintéressent
quelque peu de la lutte contre l'Angleterre. De son côté, Richard II doit
faire face en 1381 à une grave révolte paysanne. Dans ces conditions, la
guerre piétine et une trêve est finalement conclue en 1388. Prolongée à
plusieurs reprises, elle marque le début d'un rapprochement durable entre la
France et l'Angleterre. Une phase nouvelle du conflit s'ouvre.
e
décès à trois ans d'intervalle d'Edouard III puis de Charles V et l'avènement
de deux rois très jeunes, Richard II en Angleterre et Charles VI en France, créent
de nouvelles conditions dans le déroulement du conflit. En France, les oncles
du nouveau roi s'entendent pour exercer en commun le pouvoir pendant sa minorité.
Les conseillers du règne précédent, qui ont reçu le surnom de Marmousets en
raison de leur origine souvent modeste sont écartés. L'achèvement de l'œuvre
de réorganisation entreprise par Charles V est négligée. Chacun des oncles
poursuit sa politique personnelle, d'où des intrigues et des conflits
continuels. Jean de Berry veut faire fortune grâce à sa lieutenance du
Languedoc, Philippe de Bourgogne songe à la Flandre et Louis d'Anjou au royaume
de Naples. Les nouveaux impôts levés pour aider ce dernier dans ses
entreprises entraînent des troubles populaires, notamment à Rouen (la Harelle)
et à Paris (révolte des Maillotins). L'anarchie atteint également Gand qui,
sous l'impulsion de Philippe van Artevelde, fils du grand homme politique des
années 1340, réclame l'alliance économique et militaire avec l'Angleterre.
Pour le gouvernement des oncles, la révolte flamande est très dangereuse. Ils
réunissent une forte armée qui écrase les milices gantoises à Roosebeke.
(1382). Mais sollicités par leurs intérêts personnels, ils se désintéressent
quelque peu de la lutte contre l'Angleterre. De son côté, Richard II doit
faire face en 1381 à une grave révolte paysanne. Dans ces conditions, la
guerre piétine et une trêve est finalement conclue en 1388. Prolongée à
plusieurs reprises, elle marque le début d'un rapprochement durable entre la
France et l'Angleterre. Une phase nouvelle du conflit s'ouvre.
Le temps des trêves (1388-1411)
![]()
 'interruption
des hostilités est loin d'être entièrement respectée. Plusieurs fois, de sérieux
"attentats aux trêves" se produisent de part et d'autre. Mais
jusqu'en 1404, aucun des deux protagonistes ne réunit de grandes forces destinées
à frapper l'adversaire. Richard II d'Angleterre se fait le champion de cette réconciliation.
Il admire la monarchie des Valois, libre de tout contrôle populaire ou
seigneurial et rêve d'introduire un régime analogue dans son propre pays. Or,
pour secouer la tutelle des barons et du parlement, il lui semble utile de
s'appuyer sur son adversaire de la veille. En France, Charles VI, alors âgé de
20 ans, décide d'écarter la tutelle de ses oncles et de gouverner lui-même
avec l'aide de son frère Louis, futur duc d'Orléans, ainsi que d'anciens
conseillers de son père qui sont rappelés (novembre 1388). Avec le premier accès
de folie du roi en 1392, ses oncles retrouveront le pouvoir qu'ils avaient un
moment perdu. Retournement de situation qui ne modifiera pas les rapports avec
l'Angleterre.
'interruption
des hostilités est loin d'être entièrement respectée. Plusieurs fois, de sérieux
"attentats aux trêves" se produisent de part et d'autre. Mais
jusqu'en 1404, aucun des deux protagonistes ne réunit de grandes forces destinées
à frapper l'adversaire. Richard II d'Angleterre se fait le champion de cette réconciliation.
Il admire la monarchie des Valois, libre de tout contrôle populaire ou
seigneurial et rêve d'introduire un régime analogue dans son propre pays. Or,
pour secouer la tutelle des barons et du parlement, il lui semble utile de
s'appuyer sur son adversaire de la veille. En France, Charles VI, alors âgé de
20 ans, décide d'écarter la tutelle de ses oncles et de gouverner lui-même
avec l'aide de son frère Louis, futur duc d'Orléans, ainsi que d'anciens
conseillers de son père qui sont rappelés (novembre 1388). Avec le premier accès
de folie du roi en 1392, ses oncles retrouveront le pouvoir qu'ils avaient un
moment perdu. Retournement de situation qui ne modifiera pas les rapports avec
l'Angleterre.
![]()
 n
ne peut pourtant aboutir à un traité de paix entre les deux pays. La haine réciproque
est devenue trop grande et le contentieux est désormais trop lourd. De plus, la
méfiance renaît avec l'avènement sur le trône d'Angleterre d'Henri IV de
Lancastre qui s'est proclamé roi après avoir fait disparaître Richard II, son
cousin. Le nouveau roi doit en effet une bonne part de sa popularité à ses déclarations
belliqueuses et en 1404, la monarchie des Valois, profite d'un grave soulèvement
du pays de Galles et prend l'initiative d'une reprise des hostilités. Les premières
opérations françaises sont totalement infructueuses. Les rivalités qui
divisent et désolent le royaume ne sont pas étrangères à ces échecs. Depuis
la mort de Philippe le Hardi en 1404, la lutte est devenue ouverte entre le
nouveau duc de Bourgogne, Jean sans Peur, et le frère du roi, Louis d'Orléans.
Tous deux poursuivent le même but, à savoir agrandir et consolider leurs
possessions et prendre la première place dans le gouvernement de la monarchie.
L'assassinat à Paris de Louis d'Orléans par des tueurs à la solde du duc de
Bourgogne le 23 novembre 1407 rend toute réconciliation impossible.
n
ne peut pourtant aboutir à un traité de paix entre les deux pays. La haine réciproque
est devenue trop grande et le contentieux est désormais trop lourd. De plus, la
méfiance renaît avec l'avènement sur le trône d'Angleterre d'Henri IV de
Lancastre qui s'est proclamé roi après avoir fait disparaître Richard II, son
cousin. Le nouveau roi doit en effet une bonne part de sa popularité à ses déclarations
belliqueuses et en 1404, la monarchie des Valois, profite d'un grave soulèvement
du pays de Galles et prend l'initiative d'une reprise des hostilités. Les premières
opérations françaises sont totalement infructueuses. Les rivalités qui
divisent et désolent le royaume ne sont pas étrangères à ces échecs. Depuis
la mort de Philippe le Hardi en 1404, la lutte est devenue ouverte entre le
nouveau duc de Bourgogne, Jean sans Peur, et le frère du roi, Louis d'Orléans.
Tous deux poursuivent le même but, à savoir agrandir et consolider leurs
possessions et prendre la première place dans le gouvernement de la monarchie.
L'assassinat à Paris de Louis d'Orléans par des tueurs à la solde du duc de
Bourgogne le 23 novembre 1407 rend toute réconciliation impossible.
![]()
 e
geste de Jean sans Peur semble marquer la fin de sa cause. Mais faisant front,
il présente une apologie du crime dans laquelle le duc d'Orléans est dépeint
comme un tyran qu'il était légitime d'abattre. Il se campe également en
champion de la réforme monarchique contre les abus et les malversations. Du
coup, sa popularité grandit, spécialement auprès de la bourgeoisie
parisienne, et il peut s'emparer de la direction du gouvernement. Mais la
faction orléaniste, avec à sa tête le nouveau duc Charles d'Orléans et son
beau-père le comte Bernard VII d'Armagnac, contrôle encore la moitié du
royaume. Il faut donc à Jean sans Peur consolider et élargir sa position. Il
pense y parvenir en demandant l'intervention anglaise.
e
geste de Jean sans Peur semble marquer la fin de sa cause. Mais faisant front,
il présente une apologie du crime dans laquelle le duc d'Orléans est dépeint
comme un tyran qu'il était légitime d'abattre. Il se campe également en
champion de la réforme monarchique contre les abus et les malversations. Du
coup, sa popularité grandit, spécialement auprès de la bourgeoisie
parisienne, et il peut s'emparer de la direction du gouvernement. Mais la
faction orléaniste, avec à sa tête le nouveau duc Charles d'Orléans et son
beau-père le comte Bernard VII d'Armagnac, contrôle encore la moitié du
royaume. Il faut donc à Jean sans Peur consolider et élargir sa position. Il
pense y parvenir en demandant l'intervention anglaise.
La tentative anglaise de double monarchie (1411-1435).
![]()
 our
obtenir l'aide militaire d'Henri IV d'Angleterre, Jean sans Peur lui a promis
quelques villes flamandes et son aide pour conquérir la Normandie. Mais les
Armagnacs prennent à leur tour contact avec le roi d'Angleterre, lui
garantissant le recouvrement des provinces perdues depuis 1369. Dans le conseil
d'Henri IV de Lancastre, les Armagnacs l'emportent sur les Bourguignons. Un
accord est conclu en mai 1412, mais Jean sans Peur apprend la transaction.
Aussitôt les Armagnacs dénoncent le pacte. Il est trop tard, des troupes
anglaises débarquent près de Cherbourg, prennent Honfleur et traversent
l'ouest du royaume sans être inquiétées, d'autant plus que la guerre civile
fait rage entre Armagnacs et Bourguignons. Jean sans Peur, pour conserver son
prestige, entreprend le programme de réformes qu'il avait promis. En janvier
1413, il déchaîne la foule parisienne contre les Armagnacs et une fois ces
derniers massacrés, emprisonnés, chassés (épisode des Ecorcheurs), les émeutiers
obtiennent la promulgation d'une grande ordonnance qualifiée plus tard de
cabochienne, du nom de leur chef, le boucher Caboche. Mais les notables
parisiens prennent peur devant les troubles. Ils se rapprochent du dauphin Louis
de Guyenne. Le duc de Bourgogne, se voyant isolé, abandonne brusquement la
partie. C'est le retour des Armagnacs qui abolissent aussitôt l'Ordonnance
cabochienne (8 septembre 1413) et se maintiennent pendant cinq ans à Paris
malgré leur impopularité grandissante.
our
obtenir l'aide militaire d'Henri IV d'Angleterre, Jean sans Peur lui a promis
quelques villes flamandes et son aide pour conquérir la Normandie. Mais les
Armagnacs prennent à leur tour contact avec le roi d'Angleterre, lui
garantissant le recouvrement des provinces perdues depuis 1369. Dans le conseil
d'Henri IV de Lancastre, les Armagnacs l'emportent sur les Bourguignons. Un
accord est conclu en mai 1412, mais Jean sans Peur apprend la transaction.
Aussitôt les Armagnacs dénoncent le pacte. Il est trop tard, des troupes
anglaises débarquent près de Cherbourg, prennent Honfleur et traversent
l'ouest du royaume sans être inquiétées, d'autant plus que la guerre civile
fait rage entre Armagnacs et Bourguignons. Jean sans Peur, pour conserver son
prestige, entreprend le programme de réformes qu'il avait promis. En janvier
1413, il déchaîne la foule parisienne contre les Armagnacs et une fois ces
derniers massacrés, emprisonnés, chassés (épisode des Ecorcheurs), les émeutiers
obtiennent la promulgation d'une grande ordonnance qualifiée plus tard de
cabochienne, du nom de leur chef, le boucher Caboche. Mais les notables
parisiens prennent peur devant les troubles. Ils se rapprochent du dauphin Louis
de Guyenne. Le duc de Bourgogne, se voyant isolé, abandonne brusquement la
partie. C'est le retour des Armagnacs qui abolissent aussitôt l'Ordonnance
cabochienne (8 septembre 1413) et se maintiennent pendant cinq ans à Paris
malgré leur impopularité grandissante.
![]()
 n
mars 1413, Henri IV d'Angleterre meurt, laissant le trône à son fils Henri V.
Ce dernier se présente immédiatement comme l'apôtre de la paix, mais d'une
paix juste qui implique non seulement la restitution des provinces acquises par
le traité de Brétigny, mais encore de celles indûment arrachées à Jean sans
Terre par Philippe Auguste. Pour éviter l'alliance anglo-bourguignonne, les
Armagnacs sont prêts à beaucoup de concessions. Ils refusent néanmoins la
Normandie à Henri V qui juge cette province essentielle et se décide à la
guerre. Le 14 août 1415, il débarque à Chef-de-Caux. Armagnacs et
Bourguignons se sont enfin rapprochés face au péril anglais. Mais la réconciliation
n'est qu'apparente et Jean sans Peur laisse les Armagnacs lutter seuls contre
l'envahisseur. Une forte armée est réunie. Elle rencontre l'ennemi à
Azincourt le 25 octobre 1415 où elle est écrasée. La cour de France sollicite
alors la médiation du roi des Romains, Sigismond, qui se décide pour le plus
fort et s'allie avec Henri V. Peu de temps après, Jean sans Peur reconnaît
Henri V comme celui qui doit "de droit" devenir roi de France.
n
mars 1413, Henri IV d'Angleterre meurt, laissant le trône à son fils Henri V.
Ce dernier se présente immédiatement comme l'apôtre de la paix, mais d'une
paix juste qui implique non seulement la restitution des provinces acquises par
le traité de Brétigny, mais encore de celles indûment arrachées à Jean sans
Terre par Philippe Auguste. Pour éviter l'alliance anglo-bourguignonne, les
Armagnacs sont prêts à beaucoup de concessions. Ils refusent néanmoins la
Normandie à Henri V qui juge cette province essentielle et se décide à la
guerre. Le 14 août 1415, il débarque à Chef-de-Caux. Armagnacs et
Bourguignons se sont enfin rapprochés face au péril anglais. Mais la réconciliation
n'est qu'apparente et Jean sans Peur laisse les Armagnacs lutter seuls contre
l'envahisseur. Une forte armée est réunie. Elle rencontre l'ennemi à
Azincourt le 25 octobre 1415 où elle est écrasée. La cour de France sollicite
alors la médiation du roi des Romains, Sigismond, qui se décide pour le plus
fort et s'allie avec Henri V. Peu de temps après, Jean sans Peur reconnaît
Henri V comme celui qui doit "de droit" devenir roi de France.
![]()
 ort
de ces appuis, Henri V débarque de nouveau en France en août 1417 et
entreprend cette fois une conquête méthodique et systématique de la
Normandie. A Paris, le gouvernement des Armagnacs, affaibli par la défaite
d'Azincourt et par la mort du duc de Berry, du dauphin Louis et de son frère
Jean de Touraine, ne tente rien. Il doit céder la place aux Bourguignons en
juillet 1418. Le dernier fils de Charles VI, le futur Charles VII, devenu
dauphin à 15 ans en avril 1417, échappe au massacre de ses partisans. Un
rapprochement entre Armagnacs et Bourguignons s'esquisse pourtant. Après avoir
achevé la conquête de la Normandie, les Anglais deviennent menaçants pour
Paris. Mais le meurtre de Jean sans Peur par un fidèle du dauphin le 10
septembre 1419 à Montereau rend toute entente impossible pour longtemps. Henri
V d'Angleterre, qui a surtout cherché à obtenir la plus large part possible du
royaume, voit soudain la couronne de France à sa portée. Fidèle à son
attitude de vengeur et ne pouvant devenir lui-même l'héritier du trône, le
nouveau duc Philippe le Bon de Bourgogne se range avec réticence au projet
anglais de double monarchie, comme préférable au rattachement pur et simple à
l'Angleterre. Avec le soutien de la reine Isabeau de Bavière, il impose à
Charles VI la signature du traité de Troyes, le 21 mai 1420. Par ce traité,
Charles VI demeure roi jusqu'à sa mort, mais il exclut le dauphin Charles de
tous ses droits et donne sa fille Catherine en mariage à Henri V qui devient
son "fils" et "héritier de France". A la mort de son beau-père,
Henri V coiffera donc les deux couronnes qui resteront unies à jamais sous lui
et ses successeurs. Pourtant, il s'agit d'une union personnelle et non de la
fusion des deux royaumes. Chaque royaume conservera ses droits, ses libertés,
ses coutumes et ses lois. En attendant, Henri V revêt le titre de régent,
exerce le pouvoir au nom de Charles VI et garde à titre personnel le duché de
Normandie.
ort
de ces appuis, Henri V débarque de nouveau en France en août 1417 et
entreprend cette fois une conquête méthodique et systématique de la
Normandie. A Paris, le gouvernement des Armagnacs, affaibli par la défaite
d'Azincourt et par la mort du duc de Berry, du dauphin Louis et de son frère
Jean de Touraine, ne tente rien. Il doit céder la place aux Bourguignons en
juillet 1418. Le dernier fils de Charles VI, le futur Charles VII, devenu
dauphin à 15 ans en avril 1417, échappe au massacre de ses partisans. Un
rapprochement entre Armagnacs et Bourguignons s'esquisse pourtant. Après avoir
achevé la conquête de la Normandie, les Anglais deviennent menaçants pour
Paris. Mais le meurtre de Jean sans Peur par un fidèle du dauphin le 10
septembre 1419 à Montereau rend toute entente impossible pour longtemps. Henri
V d'Angleterre, qui a surtout cherché à obtenir la plus large part possible du
royaume, voit soudain la couronne de France à sa portée. Fidèle à son
attitude de vengeur et ne pouvant devenir lui-même l'héritier du trône, le
nouveau duc Philippe le Bon de Bourgogne se range avec réticence au projet
anglais de double monarchie, comme préférable au rattachement pur et simple à
l'Angleterre. Avec le soutien de la reine Isabeau de Bavière, il impose à
Charles VI la signature du traité de Troyes, le 21 mai 1420. Par ce traité,
Charles VI demeure roi jusqu'à sa mort, mais il exclut le dauphin Charles de
tous ses droits et donne sa fille Catherine en mariage à Henri V qui devient
son "fils" et "héritier de France". A la mort de son beau-père,
Henri V coiffera donc les deux couronnes qui resteront unies à jamais sous lui
et ses successeurs. Pourtant, il s'agit d'une union personnelle et non de la
fusion des deux royaumes. Chaque royaume conservera ses droits, ses libertés,
ses coutumes et ses lois. En attendant, Henri V revêt le titre de régent,
exerce le pouvoir au nom de Charles VI et garde à titre personnel le duché de
Normandie.
![]()
 ais
le dauphin et encore plus ses partisans contestent aussitôt la validité du
traité, faisant valoir que Charles VI ne peut disposer à son gré de la
couronne. D'après les règles en vigueur, il n'en est que le dépositaire et
son état mental ôte a fortiori toute valeur à sa décision. Or le
dauphin tient encore la France du Centre et du Sud, à l'exception de la
Guyenne. Dans ces conditions, Henri V est contraint d'entreprendre une conquête
de longue haleine. Peu de temps après, il meurt (août 1422). Le 21 octobre
suivant, Charles VI disparaît à son tour et, conformément au traité de
Troyes, Henri VI, fils d'Henri V et de Catherine, déjà roi d'Angleterre par la
mort de son père, devient roi de France par celle de son grand-père. Le
nouveau souverain n'a que quelques mois et c'est son oncle, le duc de Bedford,
qui prend la régence. Mais en même temps, le dauphin Charles s'est proclamé
roi sous le nom de Charles VII.
ais
le dauphin et encore plus ses partisans contestent aussitôt la validité du
traité, faisant valoir que Charles VI ne peut disposer à son gré de la
couronne. D'après les règles en vigueur, il n'en est que le dépositaire et
son état mental ôte a fortiori toute valeur à sa décision. Or le
dauphin tient encore la France du Centre et du Sud, à l'exception de la
Guyenne. Dans ces conditions, Henri V est contraint d'entreprendre une conquête
de longue haleine. Peu de temps après, il meurt (août 1422). Le 21 octobre
suivant, Charles VI disparaît à son tour et, conformément au traité de
Troyes, Henri VI, fils d'Henri V et de Catherine, déjà roi d'Angleterre par la
mort de son père, devient roi de France par celle de son grand-père. Le
nouveau souverain n'a que quelques mois et c'est son oncle, le duc de Bedford,
qui prend la régence. Mais en même temps, le dauphin Charles s'est proclamé
roi sous le nom de Charles VII.
![]()
 e
premier soin de Bedford est de relancer l'alliance anglo-bourguignonne, quelque
peu défaillante. Il rallie également à son camp le duc Jean V de Bretagne. La
guerre reprend alors. Elle n'est pas favorable à Charles VII. Refoulé au sud
de la Loire, il se voit affublé par ses adversaires du titre ironique de
"roi de Bourges". Toutefois la solidarité anglo-bourguignonne se révèle
éphémère. Des querelles dynastiques viennent opposer Philippe le Bon au duc
de Gloucester, oncle de Bedford. De son côté, Charles VII parvient à détacher
un temps Jean V du clan anglais et à conclure des trêves de plusieurs années
avec la Bourgogne. La guerre se poursuit donc contre les seuls Anglais. Une opération
qui semble décisive s'engage le 12 octobre 1428 avec le siège d'Orléans, clef
des pays d'outre-Loire.
e
premier soin de Bedford est de relancer l'alliance anglo-bourguignonne, quelque
peu défaillante. Il rallie également à son camp le duc Jean V de Bretagne. La
guerre reprend alors. Elle n'est pas favorable à Charles VII. Refoulé au sud
de la Loire, il se voit affublé par ses adversaires du titre ironique de
"roi de Bourges". Toutefois la solidarité anglo-bourguignonne se révèle
éphémère. Des querelles dynastiques viennent opposer Philippe le Bon au duc
de Gloucester, oncle de Bedford. De son côté, Charles VII parvient à détacher
un temps Jean V du clan anglais et à conclure des trêves de plusieurs années
avec la Bourgogne. La guerre se poursuit donc contre les seuls Anglais. Une opération
qui semble décisive s'engage le 12 octobre 1428 avec le siège d'Orléans, clef
des pays d'outre-Loire.
![]()
 n
ces années 1428-1429 qui se révèlent décisives, la position du souverain
Lancastre semble favorable. Il dispose, outre du royaume d'Angleterre, d'une
partie importante du royaume de France : la Guyenne, Calais et ses marches, le
duché de Normandie, les "pays de conquête" entre la frontière
normande et Paris, le Maine, l'Ile-de-France, le pays chartrain, la Champagne et
la Picardie. De plus, Jean V s'est de nouveau rapproché des Anglais en 1427.
Enfin ces derniers conservent l'alliance de Philippe le Bon qui dispose du duché
de Bourgogne et des comtés de Flandre, Boulogne, Artois, Rethel, Nevers,
Charolais et Mâcon dans le royaume ainsi que dans l'empire, de la Franche-Comté,
du comté de Namur, du Hainaut, de la Hollande et de la Zélande. Mais
l'Angleterre proprement dite n'apporte qu'une aide épisodique dans la lutte, en
vertu du principe de la double monarchie. Enfin, dans la France conquise, la
population est loin d'être ralliée. Les Anglais continuent à être considérés
comme des envahisseurs. Ses recettes fiscales permettent néanmoins à Bedford
d'assurer le paiement régulier d'une armée disciplinée, bien équipée, mais
peu nombreuse. On peut estimer à 7000 le nombre des combattants dont le régent
dispose au prix d'un effort maximum.
n
ces années 1428-1429 qui se révèlent décisives, la position du souverain
Lancastre semble favorable. Il dispose, outre du royaume d'Angleterre, d'une
partie importante du royaume de France : la Guyenne, Calais et ses marches, le
duché de Normandie, les "pays de conquête" entre la frontière
normande et Paris, le Maine, l'Ile-de-France, le pays chartrain, la Champagne et
la Picardie. De plus, Jean V s'est de nouveau rapproché des Anglais en 1427.
Enfin ces derniers conservent l'alliance de Philippe le Bon qui dispose du duché
de Bourgogne et des comtés de Flandre, Boulogne, Artois, Rethel, Nevers,
Charolais et Mâcon dans le royaume ainsi que dans l'empire, de la Franche-Comté,
du comté de Namur, du Hainaut, de la Hollande et de la Zélande. Mais
l'Angleterre proprement dite n'apporte qu'une aide épisodique dans la lutte, en
vertu du principe de la double monarchie. Enfin, dans la France conquise, la
population est loin d'être ralliée. Les Anglais continuent à être considérés
comme des envahisseurs. Ses recettes fiscales permettent néanmoins à Bedford
d'assurer le paiement régulier d'une armée disciplinée, bien équipée, mais
peu nombreuse. On peut estimer à 7000 le nombre des combattants dont le régent
dispose au prix d'un effort maximum.
![]()
 ace
à l'Angleterre, Charles VII conserve ses alliés traditionnels, la Castille et
l'Ecosse. Il trouve également dans les grandes maisons princières Anjou, Orléans,
Bourbon, Foix, Comminges un appui plus efficace que celui apporté à Bedford
par les princes français qui reconnaissent officiellement Henri VI. Mais si son
pouvoir est moins contesté, sa cour est le foyer d'intrigues sans nombre et il
ne dispose pas d'une armée régulière. La poursuite des combats repose sur
l'activité d'une centaine de "capitaines de gens d'armes et de trait"
disposant chacun de quelques dizaines d'aventuriers, autrement dit une armée de
fantassins et d'archers. Enfin, le point le plus faible réside dans la personne
de Charles VII, indolent, irrésolu, totalement dépourvu de prestige. Pour lui,
l'issue du siège d'Orléans est capitale car d'elle dépendra sa décision
d'abandonner ou de poursuivre la lutte.
ace
à l'Angleterre, Charles VII conserve ses alliés traditionnels, la Castille et
l'Ecosse. Il trouve également dans les grandes maisons princières Anjou, Orléans,
Bourbon, Foix, Comminges un appui plus efficace que celui apporté à Bedford
par les princes français qui reconnaissent officiellement Henri VI. Mais si son
pouvoir est moins contesté, sa cour est le foyer d'intrigues sans nombre et il
ne dispose pas d'une armée régulière. La poursuite des combats repose sur
l'activité d'une centaine de "capitaines de gens d'armes et de trait"
disposant chacun de quelques dizaines d'aventuriers, autrement dit une armée de
fantassins et d'archers. Enfin, le point le plus faible réside dans la personne
de Charles VII, indolent, irrésolu, totalement dépourvu de prestige. Pour lui,
l'issue du siège d'Orléans est capitale car d'elle dépendra sa décision
d'abandonner ou de poursuivre la lutte.
![]()
 a
capitulation de la ville semble proche après la journée du 12 février 1429
(journée des Harengs) au cours de laquelle les Français sont battus par
l'escorte d'un convoi de ravitaillement qu'ils avaient intercepté. Mais
l'intervention de Jeanne d'Arc va changer le cours des événements. Arrivée à
Chinon le 6 mars 1429, elle y rencontre le "gentil dauphin" et réussit
à le convaincre du caractère divin de sa mission et de la sainteté des voix
qui lui ont enjoint de chasser les Anglais hors de France. Avant d'entrer en
campagne, elle envoie un défi à ses adversaires, les sommant au nom du
"Roi du Ciel" de "rendre France". Puis elle entre dans Orléans
le 30 avril et oblige le chef anglais Suffolk à lever le siège (8 mai).
Galvanisés après ce succès, les Français reprennent Jargeau, Beaugency et
bousculent l'arrière-garde anglaise à Patay (18 juin). Jeanne décide alors
Charles VII à gagner Reims où il est sacré le 17 juillet 1429. Sa légitimité
devient manifeste.
a
capitulation de la ville semble proche après la journée du 12 février 1429
(journée des Harengs) au cours de laquelle les Français sont battus par
l'escorte d'un convoi de ravitaillement qu'ils avaient intercepté. Mais
l'intervention de Jeanne d'Arc va changer le cours des événements. Arrivée à
Chinon le 6 mars 1429, elle y rencontre le "gentil dauphin" et réussit
à le convaincre du caractère divin de sa mission et de la sainteté des voix
qui lui ont enjoint de chasser les Anglais hors de France. Avant d'entrer en
campagne, elle envoie un défi à ses adversaires, les sommant au nom du
"Roi du Ciel" de "rendre France". Puis elle entre dans Orléans
le 30 avril et oblige le chef anglais Suffolk à lever le siège (8 mai).
Galvanisés après ce succès, les Français reprennent Jargeau, Beaugency et
bousculent l'arrière-garde anglaise à Patay (18 juin). Jeanne décide alors
Charles VII à gagner Reims où il est sacré le 17 juillet 1429. Sa légitimité
devient manifeste.
![]()
 es
Anglais prennent peur mais Charles VII manque d'énergie. Il s'empare bien de
quelques villes, Laon, Soissons, Senlis et Compiègne, mais sans entreprendre
aucune action d'envergure. De plus, sa position est ébranlée par la capture de
Jeanne par les Bourguignons à Compiègne (24 mai 1430). Vendue aux Anglais, la
Pucelle est jugée à Rouen par un tribunal d'inquisition présidé par Pierre
Cauchon. Elle est condamnée comme "hérétique, relapse, apostate, idolâtre"
et brûlée à Rouen le 30 mai 1431.
es
Anglais prennent peur mais Charles VII manque d'énergie. Il s'empare bien de
quelques villes, Laon, Soissons, Senlis et Compiègne, mais sans entreprendre
aucune action d'envergure. De plus, sa position est ébranlée par la capture de
Jeanne par les Bourguignons à Compiègne (24 mai 1430). Vendue aux Anglais, la
Pucelle est jugée à Rouen par un tribunal d'inquisition présidé par Pierre
Cauchon. Elle est condamnée comme "hérétique, relapse, apostate, idolâtre"
et brûlée à Rouen le 30 mai 1431.
![]()
 e
17 décembre 1431, Henri VI qui a été sacré roi d'Angleterre deux ans plus tôt
à Westminster, se fait couronner roi de France dans la cathédrale de Paris.
Mais son triomphe n'est qu'apparent. Sa domination est de plus en plus contestée
sur le continent et la lassitude de ses troupes de plus en plus grande. Dans ces
conditions, Charles VII va pouvoir poursuivre son œuvre de libération. Pour
cela, il lui est indispensable d'obtenir l'alliance bourguignonne. Les négociations
ouvertes en 1432 traînent en longueur. Mais Philippe le Bon a compris que son
intérêt est de changer de camp. Le 21 septembre 1435, il signe avec Charles
VII la Paix d'Arras. Par ce traité, Charles VII désavoue officiellement le
meurtre de Jean sans Peur et promet d'en faire réparation. Il cède au duc de
Bourgogne les comtés de Mâcon et d'Auxerre, les châtellenies de
Bar-sur-Seine, Péronne, Montdidier et Roye, la garde de l'abbaye de Luxeuil,
les cités, places et seigneuries lui appartenant de part et d'autre de la Somme
ainsi que le Ponthieu. Cependant, il garde la possibilité de reprendre son
domaine de la Somme contre le versement de 400 000 écus. Philippe le Bon est
enfin et surtout dispensé de tout hommage à Charles VII pour les fiefs qu'il
tient dans le royaume mais, si le roi meurt avant lui, il y est contraint envers
son successeur, tout comme son héritier, s'il meurt avant Charles VII.
e
17 décembre 1431, Henri VI qui a été sacré roi d'Angleterre deux ans plus tôt
à Westminster, se fait couronner roi de France dans la cathédrale de Paris.
Mais son triomphe n'est qu'apparent. Sa domination est de plus en plus contestée
sur le continent et la lassitude de ses troupes de plus en plus grande. Dans ces
conditions, Charles VII va pouvoir poursuivre son œuvre de libération. Pour
cela, il lui est indispensable d'obtenir l'alliance bourguignonne. Les négociations
ouvertes en 1432 traînent en longueur. Mais Philippe le Bon a compris que son
intérêt est de changer de camp. Le 21 septembre 1435, il signe avec Charles
VII la Paix d'Arras. Par ce traité, Charles VII désavoue officiellement le
meurtre de Jean sans Peur et promet d'en faire réparation. Il cède au duc de
Bourgogne les comtés de Mâcon et d'Auxerre, les châtellenies de
Bar-sur-Seine, Péronne, Montdidier et Roye, la garde de l'abbaye de Luxeuil,
les cités, places et seigneuries lui appartenant de part et d'autre de la Somme
ainsi que le Ponthieu. Cependant, il garde la possibilité de reprendre son
domaine de la Somme contre le versement de 400 000 écus. Philippe le Bon est
enfin et surtout dispensé de tout hommage à Charles VII pour les fiefs qu'il
tient dans le royaume mais, si le roi meurt avant lui, il y est contraint envers
son successeur, tout comme son héritier, s'il meurt avant Charles VII.
![]()
 e
duc Philippe de Bourgogne, outre de notables satisfactions d'amour-propre, tire
de ce traité bien des avantages. Il demeure pratiquement maître de sa
politique extérieure et le traité lui donne la possibilité de reprendre sa
place prééminente auprès des Valois, possibilité toutefois démentie par la
suite. Charles VII est loin d'être totalement perdant. Il cède théoriquement
de nombreuses places, mais elles se trouvaient déjà en possession du duc de
Bourgogne. De plus, la dispense de l'hommage reposant sur la longévité du roi
et du duc actuels (respectivement 32 et 39 ans) ne peut raisonnablement durer
plus d'une trentaine d'années. Enfin ses concessions d'ordre moral seront vite
oubliées. L'importance du traité d'Arras est ailleurs. Survenant juste après
la mort du duc de Bedford, il met pratiquement un terme à l'expérience de la
double monarchie, expérience qui s'était révélée peu viable dans les deux
pays déjà très "nationaux" qu'étaient la France et l'Angleterre.
e
duc Philippe de Bourgogne, outre de notables satisfactions d'amour-propre, tire
de ce traité bien des avantages. Il demeure pratiquement maître de sa
politique extérieure et le traité lui donne la possibilité de reprendre sa
place prééminente auprès des Valois, possibilité toutefois démentie par la
suite. Charles VII est loin d'être totalement perdant. Il cède théoriquement
de nombreuses places, mais elles se trouvaient déjà en possession du duc de
Bourgogne. De plus, la dispense de l'hommage reposant sur la longévité du roi
et du duc actuels (respectivement 32 et 39 ans) ne peut raisonnablement durer
plus d'une trentaine d'années. Enfin ses concessions d'ordre moral seront vite
oubliées. L'importance du traité d'Arras est ailleurs. Survenant juste après
la mort du duc de Bedford, il met pratiquement un terme à l'expérience de la
double monarchie, expérience qui s'était révélée peu viable dans les deux
pays déjà très "nationaux" qu'étaient la France et l'Angleterre.
La reconquête française (1435-1453).
![]()
 ès
les premiers mois qui suivent la réconciliation franco-bourguignonne, les progrès
de la reconquête sont rapides. L'Ile-de-France est nettoyée et le connétable
de Richemont entre dans Paris le 13 avril 1436. Les hostilités s'ouvrent également
entre Anglais et Bourguignons, mais les intérêts économiques reprennent le
dessus et des trêves sont conclues entre les adversaires de la veille. Charles
VII se trouve de nouveau seul face à une nouvelle offensive anglaise mais il a
réduit l'engagement à un seul front. En 1440, il doit affronter un autre péril
: plusieurs princes français, qui jugent les faveurs royales insuffisantes et
les progrès de la centralisation monarchique trop rapides se liguent pour
chasser l'équipe au pouvoir. Cette Praguerie par allusion aux insurrections
hussites à peine terminées regroupe les ducs de Bourbon, de Bretagne, d'Anjou,
le comte d'Armagnac, Dunois, bâtard d'Orléans, le propre fils de Charles VII,
le dauphin Louis, et bientôt le duc de Bourgogne. Ces princes négocient même
en sous-main avec les Anglais, sans aller toutefois jusqu'à l'alliance ouverte.
Mais, cette fois, la riposte de Charles VII est énergique. Enfin, en Angleterre
même, les partisans de la guerre laissent le pouvoir au champion de la paix,
William de la Pole, comte de Suffolk. Une trêve générale est signée à
Tours, le 28 mai 1444, elle reste valable jusqu'au 1er avril 1446.
ès
les premiers mois qui suivent la réconciliation franco-bourguignonne, les progrès
de la reconquête sont rapides. L'Ile-de-France est nettoyée et le connétable
de Richemont entre dans Paris le 13 avril 1436. Les hostilités s'ouvrent également
entre Anglais et Bourguignons, mais les intérêts économiques reprennent le
dessus et des trêves sont conclues entre les adversaires de la veille. Charles
VII se trouve de nouveau seul face à une nouvelle offensive anglaise mais il a
réduit l'engagement à un seul front. En 1440, il doit affronter un autre péril
: plusieurs princes français, qui jugent les faveurs royales insuffisantes et
les progrès de la centralisation monarchique trop rapides se liguent pour
chasser l'équipe au pouvoir. Cette Praguerie par allusion aux insurrections
hussites à peine terminées regroupe les ducs de Bourbon, de Bretagne, d'Anjou,
le comte d'Armagnac, Dunois, bâtard d'Orléans, le propre fils de Charles VII,
le dauphin Louis, et bientôt le duc de Bourgogne. Ces princes négocient même
en sous-main avec les Anglais, sans aller toutefois jusqu'à l'alliance ouverte.
Mais, cette fois, la riposte de Charles VII est énergique. Enfin, en Angleterre
même, les partisans de la guerre laissent le pouvoir au champion de la paix,
William de la Pole, comte de Suffolk. Une trêve générale est signée à
Tours, le 28 mai 1444, elle reste valable jusqu'au 1er avril 1446.
![]()
 a
politique de Charles VII et de son entourage, où domine Pierre de Brézé,
soutenu par la favorite Agnès Sorel, se fait plus active. De grandes réformes
financières et militaires sont mises sur pied (ordonnances de Nancy, février
1445) et à partir de 1446-47, la monarchie dispose d'environ 7000 combattants
à cheval répartis dans l'ensemble du royaume, ravitaillés et soldés en
permanence. A ces nouvelles compagnies de la Grande Ordonnance s'ajoutent les
troupes qui tiennent la frontière autour de la Guyenne et de la Normandie.
Militairement, tout est prêt pour la reprise de la guerre.
a
politique de Charles VII et de son entourage, où domine Pierre de Brézé,
soutenu par la favorite Agnès Sorel, se fait plus active. De grandes réformes
financières et militaires sont mises sur pied (ordonnances de Nancy, février
1445) et à partir de 1446-47, la monarchie dispose d'environ 7000 combattants
à cheval répartis dans l'ensemble du royaume, ravitaillés et soldés en
permanence. A ces nouvelles compagnies de la Grande Ordonnance s'ajoutent les
troupes qui tiennent la frontière autour de la Guyenne et de la Normandie.
Militairement, tout est prêt pour la reprise de la guerre.
![]()
 ès
lors, les événements se précipitent. En 1449, Le Mans est occupé. En 1449,
le nouveau duc François Ier de Bretagne, beaucoup plus francophile
que son frère Jean V, rompt avec les Anglais. Enfin Charles VII entreprend la
reconquête de la Normandie. La campagne, admirablement conduite, dure un an,
d'août 1449 à août 1450. Après la chute de Rouen le 4 novembre 1449, Henri
VI tente un dernier effort au printemps 1450. Une armée de secours débarque à
Cherbourg le 15 mars 1450. Marchant vers le sud-est, elle rencontre les forces
françaises à Formigny (15 avril). Elle est écrasée et la reconquête française
s'achève par la prise de Caen (19 juillet) puis par celle de Cherbourg (12 août).
La perte de la Normandie signifie l'échec de la politique de Suffolk. Ce
dernier, accusé de haute trahison par le Parlement d'Angleterre, tente de fuir
mais il est assassiné en mai 1450. Sa chute est le signal d'un soulèvement
populaire dans le sud-ouest du royaume qui empêche l'Angleterre de tenter quoi
que ce soit pour sauver la Guyenne. Dès octobre 1450, Bergerac est perdue. Puis
durant l'été 1451, Charles VII rassemble une vaste armée qu'il confie à
Dunois. Bordeaux capitule le 23 juin, Bayonne le 19 août. Mais les Gascons ne
se sont pas ralliés de plein gré aux vainqueurs. Le joug de l'administration
française leur est pesant et ils regrettent l'arrêt du commerce avec
l'Angleterre. Le vieux Talbot se voit alors confier le commandement d'une dernière
expédition anglaise. Il entre dans Bordeaux en octobre 1452 et reprend la
plupart des places perdues l'année précédente. Mais il est battu par l'armée
de Charles VII devant Castillon (17 juillet 1453), et Bordeaux assiégée se
rend enfin le 19 octobre. Au même moment, Henri VI perd la raison. La place est
libre en Angleterre pour la guerre civile des Deux-Roses entre les Lancastre et
les York.
ès
lors, les événements se précipitent. En 1449, Le Mans est occupé. En 1449,
le nouveau duc François Ier de Bretagne, beaucoup plus francophile
que son frère Jean V, rompt avec les Anglais. Enfin Charles VII entreprend la
reconquête de la Normandie. La campagne, admirablement conduite, dure un an,
d'août 1449 à août 1450. Après la chute de Rouen le 4 novembre 1449, Henri
VI tente un dernier effort au printemps 1450. Une armée de secours débarque à
Cherbourg le 15 mars 1450. Marchant vers le sud-est, elle rencontre les forces
françaises à Formigny (15 avril). Elle est écrasée et la reconquête française
s'achève par la prise de Caen (19 juillet) puis par celle de Cherbourg (12 août).
La perte de la Normandie signifie l'échec de la politique de Suffolk. Ce
dernier, accusé de haute trahison par le Parlement d'Angleterre, tente de fuir
mais il est assassiné en mai 1450. Sa chute est le signal d'un soulèvement
populaire dans le sud-ouest du royaume qui empêche l'Angleterre de tenter quoi
que ce soit pour sauver la Guyenne. Dès octobre 1450, Bergerac est perdue. Puis
durant l'été 1451, Charles VII rassemble une vaste armée qu'il confie à
Dunois. Bordeaux capitule le 23 juin, Bayonne le 19 août. Mais les Gascons ne
se sont pas ralliés de plein gré aux vainqueurs. Le joug de l'administration
française leur est pesant et ils regrettent l'arrêt du commerce avec
l'Angleterre. Le vieux Talbot se voit alors confier le commandement d'une dernière
expédition anglaise. Il entre dans Bordeaux en octobre 1452 et reprend la
plupart des places perdues l'année précédente. Mais il est battu par l'armée
de Charles VII devant Castillon (17 juillet 1453), et Bordeaux assiégée se
rend enfin le 19 octobre. Au même moment, Henri VI perd la raison. La place est
libre en Angleterre pour la guerre civile des Deux-Roses entre les Lancastre et
les York.
![]()
 a
guerre de Cent Ans s'achève donc par le retour de la province qui en était
l'enjeu. Mais aucun traité ne vient sanctionner son terme et longtemps après
la reprise de la Guyenne, les Français craignent un retour offensif de
l'adversaire. Edouard IV d'York songe à plusieurs occasions à relancer la
guerre en France avec l'appui de la Bourgogne et de la Bretagne. Ses initiatives
sont sans lendemain. Lorsqu'il débarque à Calais en juillet 1475, il n'y
trouve personne pour l'appuyer et signe alors la trêve de Picquigny (29 août
1475). Cette simple trêve met un point final aux entreprises anglaises sur le
continent. Mais les rois d'Angleterre conservent Calais jusqu'en 1553 et portent
le titre de roi de France pendant plusieurs siècles, jusqu'au traité d'Amiens
de 1802 qui, de droit, met véritablement fin à la guerre de Cent Ans.
a
guerre de Cent Ans s'achève donc par le retour de la province qui en était
l'enjeu. Mais aucun traité ne vient sanctionner son terme et longtemps après
la reprise de la Guyenne, les Français craignent un retour offensif de
l'adversaire. Edouard IV d'York songe à plusieurs occasions à relancer la
guerre en France avec l'appui de la Bourgogne et de la Bretagne. Ses initiatives
sont sans lendemain. Lorsqu'il débarque à Calais en juillet 1475, il n'y
trouve personne pour l'appuyer et signe alors la trêve de Picquigny (29 août
1475). Cette simple trêve met un point final aux entreprises anglaises sur le
continent. Mais les rois d'Angleterre conservent Calais jusqu'en 1553 et portent
le titre de roi de France pendant plusieurs siècles, jusqu'au traité d'Amiens
de 1802 qui, de droit, met véritablement fin à la guerre de Cent Ans.
![]()
 a
France sort donc victorieuse d'un conflit où par deux fois, elle a failli
sombrer. Elle en sort meurtrie, épuisée matériellement, mais plus unifiée et
plus consciente d'elle-même. Par sa durée même, l'affrontement commencé
comme une guerre féodale, a développé chez les Français comme chez les
Anglais une xénophobie et un nationalisme marqués qui, à leur tour, ont
nourri et prolongé la lutte. En France, le pouvoir monarchique, qui aurait pu
se disloquer dans l'épreuve, en sort au contraire considérablement renforcé
et prêt à poursuivre sa marche vers l'absolutisme.
a
France sort donc victorieuse d'un conflit où par deux fois, elle a failli
sombrer. Elle en sort meurtrie, épuisée matériellement, mais plus unifiée et
plus consciente d'elle-même. Par sa durée même, l'affrontement commencé
comme une guerre féodale, a développé chez les Français comme chez les
Anglais une xénophobie et un nationalisme marqués qui, à leur tour, ont
nourri et prolongé la lutte. En France, le pouvoir monarchique, qui aurait pu
se disloquer dans l'épreuve, en sort au contraire considérablement renforcé
et prêt à poursuivre sa marche vers l'absolutisme.
![]()
 orsque
la guerre prend si discrètement fin, la France médiévale a déjà cédé la
place à une nation moderne par bien des aspects, à l'aube des grandes découvertes
de la Renaissance et de la Réforme.
orsque
la guerre prend si discrètement fin, la France médiévale a déjà cédé la
place à une nation moderne par bien des aspects, à l'aube des grandes découvertes
de la Renaissance et de la Réforme.
I. ACCUEIL II. ARMEMENT
III. CIVILISATION IV.
GLOSSAIRES V. HABITATIONS
VI. HERALDIQUE VII.
HISTOIRE
VIII. HOMMES IX. INSOLITE
X. SOURCES &
LIENS XI. QUESTIONS & IDEES
XII. COUP DE MAIN XIII. LIVRE D'OR